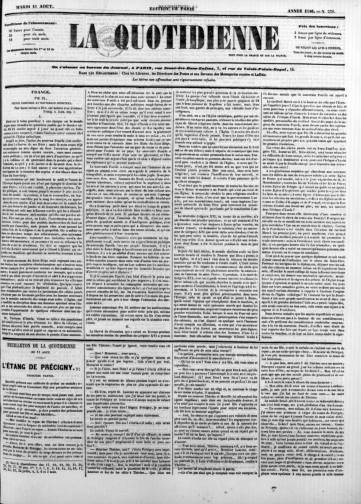Extrait du journal
même sans durée est une fiction. Si Dieu n’était pas éternel, il ne serait pas un, il ne serait rien. La République n’est donc qu’un accident, plus ou moins pro bable. Elle peut paraître dans la rue, mais comme l’anarchie peut y paraître. La République n’est pas une solution des révolutions. Elle en est une complication, rien de plus. Aussi l’instinct nubile s’éloigne avec épouvante de la Républi que. quelque droit logique qu’on lui ait fait de se produire, dans l’absence du principe constitutif de la nationalité française. C'est que l’image des désordres s’offre à sa suite, et les plus intrépides logiciens s’arrêtent devant cette conséquence naturelle de leurs propres idées. Républicains par la théorie, la plupart des hommes repoussent la pratique comme un objet d’effroi. Ils sont inconsèqiiens ; mais ils ont raison. L’instinct de la conserva tion prévaut contre la volonté la plus résolue. On ne pourra rien contre ce besoin naturel des hommes d’avi ser au soin de leur vie et de b nr bien être. Ce besoin est plus puis sant que tous les autres, plus puissant même que cette indépen dance d’esprit qui fait les révolutions depuis six mille ans. Ainsi l'homme terni à s’affranchir de l’autorité, et lorsqu’il prévoit que toute autorité aura cessé d’être, il s’arrête tremblant, et par là même il donne lieu à des pouvoir contre nature. A défaut d’au torité, il laisse créer la force. Ost ainsi que le protestantisme a fait le despotisme, c’est ainsi que la République a fait la tyrannie des centralisations révolutionnaires, la plus effroyable énormité qui se soit vue dans l’histoire des peuples. Et les hommes ont accepté ces semhlans d’ordre, de peur de l’anarchie, le pire des fléaux humains. Toujours est-il qu’en principe la dissension est le fonds de la théorie républicaine, par conséquent la faiblesse et la ruine de la nation. Donc l’objet et le devoir de la presse est de ramener les opi nions à un autre principe, pour les conduire à l’unité. Nous paraissons toujours suspects, lorsque nous disons que l’unité est dans nos principes, point ailleurs. Mais aue la presse soit sincère, et qu’elle interroge les temps passés et les temps présens. Elle verra bien, qu’à part les pré ventions, les haines ou les craintes, il y a, dans un état comme la France, une condition de durée qui fait l’unité, et hors de la quelle ou ne saurait trouver que des entreprises toujours re nouvelées, et toujours également légitimes de perturba lion. La presse, en cette question, doit se poser à une grande luutetii, puni uunimei it3|M..uiuU Elle doit se demander s'il est dans la nature des choses qu’un pays reste inflexiblement condamné à un tel ordre politique, que la paix lui soit impossible comme la guerre. Cela est-il juste? cela est-il moral ? cela peut-il être ? Si cela ne peut être, sans blesser profondément le sens social, la presse doit chercher quel est l’ordre qui naturellement fait revenir le pays à sa condition de vie. Et jugeant la question à ce liant point de vue, la presse est sûre de dominer toutes les personnalités sans exception. Pour notre compte, nous mettrons, grâce à Dieu, dans cette recherche, de la générosité et du désintéressement Il y a des gens qui supposent que le principe d'unité, tel qu’il résulte de l’histoire, appartient de droit à une fraction quelconque de la nation; par là mêmeils lui ôtent son caractère de généralité et d’unité. Mais ce principe est universel, ou il n’est rien. C’est par là même qu’il est distinct des théories accidentelles d’oit dérivent des constitutions passagères de pouvoir. La presse doit à cet égard attaquer les préventions, sous peine de perpétuer l’anarchie. Ici se ré1 èle pour elle un grand ollice. Et (lisotis-le. tout nous fait croire qu'elle l’embrassera avec zèle et avec impartialité, Tous les jours nous voyons de grands progrès vers un système de conciliation et d’harmonie. La presse se défait des vieux pré jugés. le s journaux délaissent les idées de parti, et embrassent les idées politiques. Nous ne prétendons pas, à Dieu ne plaise ! que les journaux soient les maîtres de la soci -té ; mais comme à tout prendre, c’est en eux que se trouve aujourd’hui l’Intelligence de ses besoins, il est utile que d’eux aussi partent de bons con seils et de hauts averlisscmcns, sur la fin des crises qui la tra vaillent. Nous ne pouvons tout dire ici. Mais que notre pensée soit com prise. C’est la pensée de quiconque croit à la grandeur, à la di gnité, à la liberté de la France. Laissons, il est temps, les dé fiances réciproques, les accusations, les griefs, les souvenirs, les fautes, les craintes, tout ce (pii divise ce peuple, autrefois si grand par l’unité. Voyons notre situation de faiblesse, voyons les insultes qui font baisser notre front, voyons la cause de notre im puissance, voyons la nature du mal qui nous ronge; et puis, lors que nous saurons à quoi nous en prendre d’un état si désespéré, agissons avec ensemble. Ce n’est point ici la cause d’un parti, d une coterie, d’une fraction nationale quelconque, c’est la cause de la France....
À propos
Publié d’abord sous le nom La Quotidienne en 1792, ce journal royaliste est l’organe principal de Joseph-François Michaud. Historien des croisades, ce dernier est d'abord républicain, puis devient royaliste par hostilité à la Convention. Ces revirements firent changer le journal de nom plusieurs fois durant la Révolution, l’Empire et la Restauration avant de retrouver, en 1814, son titre initial. En 1815, le journal devient la Feuille du jour.
Données de classification - lissier
- canning
- alméida
- thiers
- don miguel
- france
- espagne
- paris
- angleterre
- londres
- autriche
- nouvelle-orléans
- europe
- cos
- wellington
- la république
- lsi
- union