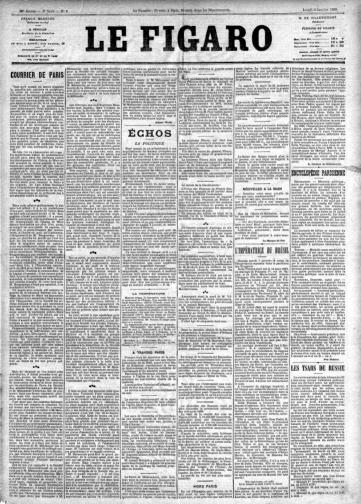Extrait du journal
culté bravement vaincue, voire l'impossibilité audacieusement niée. Mais au point de «vue de la réalité, que d'erreurs, que d'hérésies ! J'en ai vu rarement accumuler un plus grand nombre dans une œuvre de cette nature, bien que je ne connaisse peut-être pas une seule reproduction de cheval, en bronze, en marbre, en pierre, qui n'en contienne sa bonne part, surtout lorsqu'elle prétend à donner l'impres sion d'un mouvement violent. Voyons celle-ci. Jeanne, revêtue de son armure de guerre, debout dans sa selle à piquer, son épée dans la main droite, son étendard fleurdelisé dans la main gauche, montée sur un vigoureux étalon, charge furieusement l'ennemi. La visière du casque est relevée.. C'est une première erreur. Le chevalier du quinzième siècle n'allait pas au combat la visière du cas que relevée, mais au contraire complètement baissée. Je reconnais que l'erreur est vénielle et était inévitable. Il fallait bien laisser aper cevoir le visage de l'héroïne. Et, pour moi, je l'excuse d'autant plus volontiers, que cç visage est, à mon avis, le meilleur morceau de l'œuvre et rend bien l'expression inspirée, illuminée même, que l'on se plaît à supposer à Jeanne. Mais, pourquoi cette cotte de maille qui continue le casque, l'alourdit et produit, à quelques pas, l'effet d'un cache-nez que la guerrière se serait noué autour du cou, comme si elle avait mal à la gorge ? Ce n'est peut-être pas inexact; mais c'est fort laid. Puis, à quoi rime cette pelisse flottante dans le dos ? De -quelle utilité pourrait-elle être, à un personnage aussi couvert de fer, le person nage fût-il une femme ? En revanche,- elle constitue évidemment une gêne. Enfin, elle n'est pas du temps. Jeanne est toute d'une pièce, du cimier de son casque à la pointe de ses jambières, le haut du corps très renversé en arrière et, natu rellement, les jambes en avant. Eh bien, elle n'irait pas loin comme cela. On ne charge pas dans cette position d'équilibre instable. Au premier obstacle qu'on rencontrerait au bout de son arme, le corps d'un adversaire, par exemple, on serait sûrement désarçonné. Il y a un ou deux régiments de cuirassiers à Paris, je crois, M. Roulleau n'a, pour s'en assurer, qu'à prier le colonel de l'un d'eux de faire charger devant lui quelques-uns de ses cava liers. Puis, avec son épée dans la main droite, son étendard dans la main gauche, la guerrière a forcément lâché ses rênes, ce qui serait fort imprudent, surtout à pareille allure. Avec quoi conduit-elle et soutient-elle son cheval ? Avec la grâce de Dieu ? Soit. Mais, j'avoue que cela ne me paraît pas suffisant. Enfin, quelle est l'allure du cheval ? Il ne ga lope pas. Il franchit un groupe de soldats anglais, qu'il vient de renverser. Or, il n'irait assurément pas de ce'train, après un choc pa reil et tout récent, car les soldats sont encore entre ses quatre membres. De plus, M. Roul leau peut tenir pour certain que les lourds-car valiers bardés de fer,contemporains de Jeanne; ne poussaient pas à ce train endiablé leurs non moins lourds coursiers. Le harnais manque également d'exactitude. La selle à piquer a bien le pommeau saillant qu'elle doit avoir, mais le troussequin est trop menu et trop frêle.Le chevalier était mieux em boîté que cela par sa selle. Puis, ce n'est pas là un harnais de bataille, c'est le harnais de parade ou de carrousel. La monture du cheva lier du moyen âge combattant était ellemême protégée par un frontal et un chanfrein de fer, caparaçonnée d'une cotte de maille. Enfin, dans le mouvement violent qu'il exé cute et qui, je le répète, n'est'pas de l'époque,: le cheval ouvre largement la bouche, ce qui permet de voir que la langue est placée sur1 l'embouchure du mors. Ce n'est qu'un petit détail sans doute, mais i! est encore faux. Lorsqu'un cheval est correctement bridé, la langue doit se trouver sous l'embouchure du mors et non dessus. Le dernier cavalier de 2e classe de l'un quelconque de nos régiments de cavalerie sait cela. Donc, Jeanne, sa monture et le harnais de celle-ci sont absolument dans le faux. A cela près, je veux bien reconnaître que l'œuvre est parfaite I Un vieux cavalier....
À propos
En 1854, quatorze ans après la disparition du petit journal subversif du temps de Charles X, Hippolyte de Villemessant relance Le Figaro. Paraissant d’abord sous la forme d’une petite feuille de chou littéraire, Le Figaro absorbe L’Événement en 1866 pour devenir, sans transition, le grand quotidien conservateur que l’on connaît. Dès les années 1880, il abandonne la cause du monarchisme pour adhérer aux principes républicains.
Données de classification - poincaré
- gyp
- peytral
- pavie
- clémenceau
- henry maret
- gambetta
- humann
- taine
- paul verlaine
- france
- paris
- algérie
- angleterre
- pluvier
- châlons
- londres
- chambre
- stenay
- orléans
- parlement
- la république
- comité d'artil lerie
- union
- drouot
- cour de cassation
- sénat
- journal officiel
- p. m.
- ambassade de france