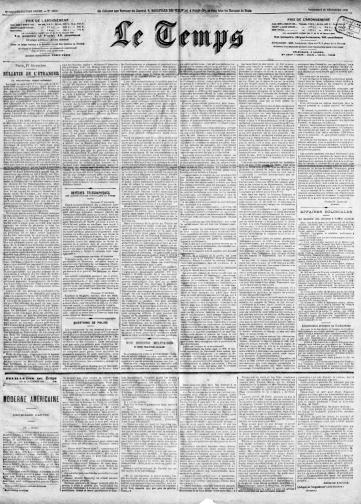Extrait du journal
dres villages, vos noms sont prononces avec respect, avec amour. » L’adihiratiori qu’ont méritée nos agents dans ^exécution doit-elle s’étendre jusquanx concep tions pour lesquelles on les a mis en marche ? En d’autres termes, les missions qu’on leur a confiées et qu’ils ont si brillamment remplies étaient-elles opportunes ? On va voir qu’il y a aujourd’hui encore le plus grand intérêt à se le demander. A vol d’oiseau, les territoires dont les traités nous ont reconnu la possession dans l’Afrique noire sontgrandscommesixàseptfoislaFrance. C’est un champ immense. La question qui se pose à nous est de savoir si nous devons entre prendre de l’exploiter immédiatement dans sa totalité ou s’il convient dé procéder par étapes et de sérier nos efforts. Au fond, c’est une ques tion d’argent. Chaque pays nouveau qu’on, or ganise a besoin des subventions de la métropole pour équilibrer son budget pendant une période plus ou moins longue. Il s’agit donc de savoir si nous sommes assez riche pour subventionner à la fois tous ces pays. L’état de nos finances répond que non. Notre budget colonial est déjà excessif; il faudrait le réduire et non l’accroître. La nécessité nous commande donc de n’orga niser ces pays que les uns après les autres de manière à espacer les dépenses. Ceci admis, par quels pays convient-il de commencer? Dans l’état actuel de nos connais sances, il en est deux qui à un beaucoup plus haut point que tous les autres paraissent pré senter les conditions d’un développement ra pide. D’une part, c’est la vallée du Niger sur les onze,cents kilomètres soumis à des inondations analogues à celles du Nil : terres fertiles, arro sement régulier, populations déjà accoutumées au travail, on y trouve tout ce qu’il faut pour créer une autre Egypte; nous devrions tirer de là les 17Û.millions de coton que notre industrie demande actuellement à l’étranger. D’autre part, c’est la région forestière du Congo avec tous les produits naturels immédiatement exploitables qu’elle renferme. Il est clair que, si l’on faisait les frais nécessaires pour mettre ces pays en valeur, ils pourraient promptement arriver à se, suffire à eux-mêmes et devenir une base d’opérations, un centre de ressources pour pousser plus loin notre expansion économique. Les pays du Tchad peuvent-ils se comparer à la vallée du Niger et à la région forestière du Congo? Interrogeons M. Gentil lui-même. Nous ne cessons de répéter que le Tchad est une nappe d’eau inutilisable; M. Gentil constate : « Le grand lac. est navigable en toute saison, à condition de se tenir de trois à cinq kilomètres de la côte »; ce qui veut dire qu’on ne peut pas approcher des bords, et comme on ne navigue que pour aborder, concluez. Nous ne cessons de répéter que la région n’offre aucun élément de commerce important; M. Gentil constate : « La région du Tchad est riche en bétail et en grains de toutes sortes, le blé même y vient; de plus sa nombreuse population produit des cuirs, des plumes d’autruche.» En dehors des plumes d’autruche, article bien secondaire, quèlles sont celles de ces marchandises qui pourraient supporter les frais d’un transport à la côte ? M. Foureau avait dit plus catégorique ment : « Le sol est fécond, mais cultive en pro duits dont je ne vois guère l’écoulement possi ble vers la métropole. » Il est vrai que les deux explorateurs expriment l’espoir que du moins les populations nous achèterons nos produits à nous ; mais si elles n’en ont pas à nous vendre, comment les payeront-elles? Ils ont oublié de l’indiquér. Donc sur le Niger et au Congo, un avenir éco nomique certain et prompt ; autour du Tchad, un. avenir économique encore fort probléma tique. Du moment que nous ne pouvons pas tout faire à la fois, le bon sens ne voudrait-il pas que nous concentrions d'abord nos efforts sur les premiers? C’est le contraire qui se passe, et qu’arrive-t-il ? C’est que comme les ressources de notre budget colonial sont limitées, quand nous avons jeté notre argent dans des entre prises improductives, nous n’en avons plus pour les entreprises utiles, si au lieu de dépenser 12 à 1,500,000 francs par an dans le Zinder, on les.employait sur le Niger, on pourrait étudier le>ëgime des eaux du fleuve, reconnaître la su perficie des terrains inondables, faire l’expé rience des espèces de coton qui conviennent au pays et prendre les mesures nécessaires pour amener les indigènes à cette culture, de ma nière qu’elle soit en train lorsque l’achèvement du chemin de fer de Kayes à Bammako permet tra d’écouler les récoltes en France. Si, au lieu de dépenser deux à trois millions de francs par an dans le Chari, on les employait dans le Congo, on pourrait y organiser une police sé...
À propos
Le Temps, nommé en référence au célèbre Times anglais, fut fondé en 1861 par le journaliste Auguste Neffzer ; il en fit le grand organe libéral français. Il se distingue des autres publications par son grand format et son prix, trois fois plus élevé que les autres quotidiens populaires. Son tirage est bien inférieur à son audience, considérable, en particulier auprès des élites politiques et financières.
Données de classification - gentil
- lara
- barretta
- de szell
- laumonier
- beaumarchais
- molière
- sophocle
- paul bénazet
- loubet
- suzanne
- congo
- niger
- rome
- le niger
- russie
- chine
- hongrie
- chari
- le congo
- la république
- m. x
- garrett
- centre de ressources
- orange