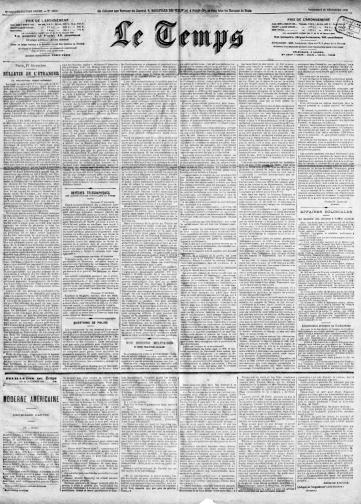Extrait du journal
On a vu hier en Dernière heure que le gou vernement avait pris la résolution, dans le conseil des ministres tenu le matin, de combat tre l’amendement Touron, en vertu duquel les agents et employés des chemins de fer démis sionnaires ou congédiés pour cause de grève, perdraient leur droit à la pension de retraite et ne pourraient exiger que le remboursement de leurs versements. Il était même annoncé que la question de cabinet serait posée s’il était nécessaire. On attendait avec quelque curiosité les rai sons de cette décision, un peu déconcertante. Ces raisons, le ministre des travaux publics, M. Barthou, les a exposées peu de temps après au Sénat, avec une habileté que personne n’es sayera de lui contester. Son argument principal a été en substance celui-ci : par son amende ment, M. Touron veut, à l’occasion d’une loi sur les retraites, faire trancher la question de sa voir si le droit de grève doit ou non être re connu aux agents et employés des chemins de fer; et cela n’est pas admissible. S’il s’en était tenu là, quelque discutable que soit cette thèse, passe encore. Mais pour la soutenir, il a eu recours aux raisonnements les plus dangereux — et tranchons lè mot — les moins probants sur le droit commun, applicable, a-t-il dit, à cette catégorie de salariés. D’abord, il a posé en principe que leur assimilation aux ouvriers de l’industrie privée ne pouvait faire doute. Et pour justifier cette assertion, il a rappelé la fameuse motion par laquelle, en 1894, la Chambre déclara —avec quelle imprudence, on l’a vu depuis! -r- que les ouvriers et employés de l’Etat devaient bénéfi cier des dispositions de la loi sur les syndicats professionnels, au même titre que ceux qui sont au service de patrons ordinaires. M. le mi nistre des travaux publics n'a même pas hésité à s’approprier cette doctrine. Mais il eût été bien embarrassé de produire une décision souveraine de justice admettant une telle interprétation. Depuis quand, en effet, la Chambre, à elle seule, a-t-elle capacité de refaire la loi, par voie d’in terprétation? Or, ce n’est que par une mécon naissance absolue des principes mêmes qui ont présidé à l’élaboration de cette loi, que son applicabilité aux ouvriers attachés à un service public, géré directement par l’Etat, ou en vertu d’une délégation de l’Etat par un concession naire, a pu être admise. Et pourquoi ? Pour une raison bien simple, et c’est précisément qu'au cune assimilation n’est possible entre un ser vice public et une entreprise particulière ; c’est que les agents, quels qu’ils soient, d’un service public, ne peuvent revêtir la physionomie, au point de vue juridique, en cette matière, des agents d’une exploitation privée. La loi de 1884, il ne faut pas l’oublier, est une loi d’égalité. Elle concède aux ouvriers et aux patrons, pour l’étude et la défense de leurs intérêts, les mêmes droits. Les uns et les autres peuvent former des associations syndicales et des unions d’associa tions dans ce but. 1 Les armes mises entre les mains des uns sont également mises entre les mains des au tres. Et parmi ces armes, figure incontestable ment, pour les ouvriers, le droit de. grève^et pour les patrons, le lock-out. Si les premiers ont très légalement la faculté de déserter collec tivement les chantiers ou ateliers, les seconds, non moins légalement, peuvent fermer ces chantiers ou ateliers, s’ils estiment cette me sure nécessaire à la défense de leurs intérêts. Ni dans l’un ni dans l’autre cas,i!n’yadélit, et il n’y a même pas de quasi-délit, si les délais de prévenance sont observés. Mais est-ce que l’Etat ou les compagnies char gées, à sa: place, d’assurer , un service public peuvent ainsi, à leur gré, et s’ils se trouvent en présence de prétentions insupportables de leurs agents,interrompre ce service? Ils n’en ont pas le droit. Car c'est pour l’utilité publique uni quement que les services publics sont créés, même lorsque leur gestion est concédée. Et en face de ces patrons, ou soi-disant tels, ainsi désarmés, il y aurait des agents armés du droit de grève, qufpourraient, eux, d’une façon licite, impunément, interrompre ces mêmes services I '...
À propos
Le Temps, nommé en référence au célèbre Times anglais, fut fondé en 1861 par le journaliste Auguste Neffzer ; il en fit le grand organe libéral français. Il se distingue des autres publications par son grand format et son prix, trois fois plus élevé que les autres quotidiens populaires. Son tirage est bien inférieur à son audience, considérable, en particulier auprès des élites politiques et financières.
Données de classification - giolitti
- darmoise
- de maisonneuve
- addo
- aymard
- chardon
- stendhal
- vivo
- fortis
- caillaux
- paris
- puebla
- sedan
- chambre
- mexique
- france
- guer
- dar
- tonkin
- versailles
- sénat
- compagnie des messageries maritimes
- confédération générale du travail
- etat français