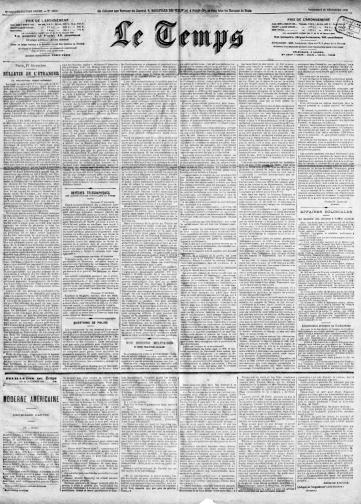Extrait du journal
comme aussi dans ceux du commerce. Et la mé vente s’annonçait comme devant résulter d’une surabondance de vins que la consommation cou rante pouvait d’autant moins absorber que le com merce sé montrait, depuis plusieurs mois, peu dis posé à acheter. C’est que les négociants du Midi ont éprouvé, l’an née dernière, une crise très grave, et ils ne pou vaient, dans ces conditions, faire preuve à l’égard de la propriété de dispositions favorables. Ce n’était pas d’ailleurs leur intérêt. On n’est guère acheteur d’une marchandise en « mévente ». On escompte toujours une baisse nouvelle. Mais quand bien même ils eussent, voulu aider la propriété pour enrayer la dépréciation des vins, les commerçants ne l’auraient pas pu, parce que l’année 1899-1900 avait été désas treuse pour nombre d’entre eux. Voici pourquoi : En août 1899, le commerce des vins était démuni. La production de 1898 avait été médiocre dans le Midi et les négociant n’avaient plus en cave do vins lé gers avec lesquels on coupe les vins plus corsés de l’Algérie et de l’Espagne. .Ainsi le stock général en France était évalué à 3 millions d’hectolitres alors qu’il devait être d’environ 10 millions. A ce moment, on demandait sur les marchés do Nîmes, de Mont pellier, de Béziers, de Narbonne, de Carcassonne et de Pézenas, les' vins disponibles à raison de 20 et 22 francs l’hectolitre. Telle était la pénurie, que l’on payait à ce prix des vins légers de plaine achetés, parfois, même, sur. souche quelques semaines avant la. vendange! . ; Que firent les propriétaires ? Ils se-hâtèrent de vendanger, prenant quelquefois les raisins avant leur maturité complète, et comme la récolte de 1899, sans être extraordinaire dans l’ensemble de la France, fut très belle dans le Midi, il éô; produisit une abondanco d’offres auxquelles les contreparties ' ne manquèrent pas, tout d’abord, puisque le com merce.avait besoin de vin. Dé là les hauts prix payés pendant six mois. Seulement — car en tout il y a. un seulement — le Midi avait récolté plus que ne le comporte, en fait, la consommation courante. L’Hérault avait donné 12.300.000 hectolitres au lieu de 8 millions en 1898; l’Aude avait produit 5,330,000 hectolitres au lieu de 3.100.000 l’année précédente; dans les PyrénéesOrientales, on récolta 2,915,000 hectolitres alors que la production de 1898 n’avait pas dépassé^ 1,500,000 hectolitres; lo vignoble du Gard donna 3,650,000 hectolitres et celui des Bouches-du-Rhône produi sit 1,324,000 hectolitres au lieu de 915,000. En - som mé, ces cinq départements récoltèrent à eux seuls plus de 25 millions d’hectolitres, c’est-à-dire plus de 10 millions de plus que dans l’année 1898. Avec ce supplément de production, le commerce reconstitua ses approvisionnements. Mais la récolte avait été telle qu’il restait beaucoup do disponible sur le , marché, et les négociants prévirent, avec un sentiment facile à concevoir, que le vin qu’ils avaient en magasin allait se déprécier, en raison du stock restant chez les récoltants. C’est alors que les achats diminuèrent et que les prix se mirent à baisser fortement à partir des mois d’avril-mai, quand on commença à voir que la préparation de la récolte de 1900 s’annonçait bien. Ce fut pis quand la saison s’avança et lorsque, de semaine en se maine, l’année vinicole se présenta dans les condi tions de plus en plus favorables. La baisse s’accen tuait. La perte du commerce sur ses approvisionne ments devint de jour en jour plus considérable et beaucoup de maisons ont subi ainsi une crise qui a nécessairement réduit leurs capitaux etdiminuéleur capacité.d’achat. Cette crise commerciale a eu son contre-coup sur la crise actuelle, en ce sens qu’elle a coïncidé avec l’augmentation des offres faites par les propriétai res du Midi devant les magnifiques apparences de •l’année 1900. Pour entonner cette récolte, il a fallu tout d’abord se débarrasser des excédents de la récolte de 1899. Or, 11 n’est pour ainsi dire pas de propriétaire qui soit à même de conserver dans son cellier du vin d’une récolte sur l’autre. Aussi a-t-on commencé dès lu mois d’août à offrir sur les marchés du Midi ces « excédents » de 1899. On a beaucoup discuté sur l’importance de ces excédents. Les uns les ont grossis outre mesure ; les autres ont déclaré qu’ils étaient presque nuis. A vrai dire, on ne peut guère le savoir exactement parce que, si l’on connaît par lo service des contributions indirectes quelle quantité de vin sort de chez les ré coltants, on ignore absolument ce qui peut exister dans leurs foudres. Mais, en tout état de cause, on a beaucoup vendu,de ces excédents et il en existe en core d’assez grandes quantités à droite et à gauche, là où les propriétaires ont pu trouver des foudres ou, des futailles vides pour les loger. Ce qui d’ailleurs ne fut pas facile. En effet, dès que la récolte s’annonça comme exceptionnelle, les négociants et les propriétaires avisés se mirent à acheter des fûts vides ou à pas ser des contrats de location avec des marchands de futailles. Les cours s’accrurent dans des proportions grandissantes. On vendait 12 et 15 francs des vieil les barriques. Devant le renchérissement des merrains do ehéne pu des planches de châtaignier avec lesquels on fait les tonneaux, le prix do la futaille neuve s’accrut tout naturellement. Les transports, ces grosses pièces contenant environ 580 litres, dans lesquels on effectue le transport des vins, coûtèrent parfois 50 francs au lieu d’une quarantaine au maxi...
À propos
Le Temps, nommé en référence au célèbre Times anglais, fut fondé en 1861 par le journaliste Auguste Neffzer ; il en fit le grand organe libéral français. Il se distingue des autres publications par son grand format et son prix, trois fois plus élevé que les autres quotidiens populaires. Son tirage est bien inférieur à son audience, considérable, en particulier auprès des élites politiques et financières.
Données de classification - lauderdale
- delcassé
- robert
- bülow
- bryan
- jach
- adrien hébrard
- de szell
- jacques
- john hay
- ralston
- pékin
- paris
- bright
- france
- turin
- hongrie
- alsace-lorraine
- gard
- berlin
- union
- parti radical
- la république
- ecole polytechnique
- daily mail
- parlement
- sénat
- parti populaire
- union postale
- cologne