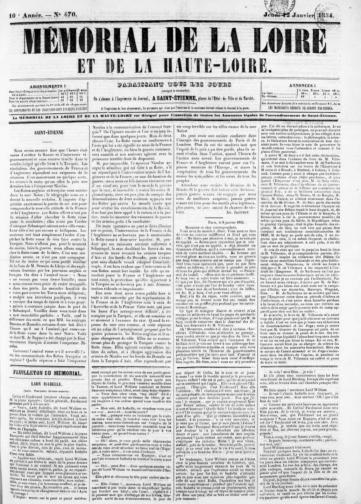Extrait du journal
L’âme socialiste Quelles qu'en doivent être les suites, nous approchons du jour où les questions posées par la surenchère électorale et les propagandes socialistes, écartées si long temps par des ajournements habiles, s’imposeront avec une acuité irrésistible. Que nous réserve, d’ici à quelque mois, cette agitation des cheminots ?.. La Haute Banque s'en inquiétait, il y a quinze ou dix-huit mois ; nous le savons par les confidences « d'un premier violon du grand orchestre », à Drumond. Il nous annonçait un désastre financier et indus triel, « par un ciel serein », alors que la rente serait au pair. La prédiction ne s’est pas réalisée, pour ce dernier point, mais la crise n’en est pas moins grave, et les esprits d’élite, comme Drumont luimême, Bourget .Deherme, impuissants à la conjurer, cherchent à en connaître au moins la cause. La cause ? Elle est évidemment dans les luttes de classes, dans les haines sociales, exacerbées à plaisir par des politiciens sans scrupules, par des arrivistes sans vergogne, par de théoriticiens sans cer velle, quand ils sont sincères... Mais la cause même de ces haines farouches, dont parle Bourget, dans sa préface de la « Barricade », et dont Drumont se fait l’écho, dans son article d’avant-hier ? On en a donné et on en donnera toutes sortes de raisons ; chacune aura peutêtre sa part de vérité, et pour notre compte, nous croyons que la principale est celle-ci : c’est en voulant rapprocher les classes, en abattant les barrières qui les séparaient, et où chacune vivait de sa vie propre et traditionnelle,qu’on a rendu leur contact douloureux. — « Si vous me rapprochez de vous, c’est que je vous vaux ; si c’est vrai, en ce moment, pour quoi cela sera-t-il faux demain, dans la vie civile, dans la politique, à l’atelier, par exemple ? Drumont cite, dans son article, le met teur en pages de son journal, qu’Emile de Girardin, dans les dîners de sa rédaction, plaçait toujours à sa droite. C’était un honneur, sans doute ; mais le lendemain le metteur en pages ne se retrouvait pas moins un simple ouvrier, et il souffrait de cete organisation sociale qui, l’ayant mis bénévolement, fa veille, au premier rang, le rejetait, le lendemain, dans la foule. Donc, cette organisation était mauvaise et il fallait la changer, coûte que coûte, pour arriver à l’établissement d’une so ciété égalitaire, basée seulement sur le mérite, sur le talent, sur la vertu... Nous connaissons la musique, brodée sur ce thème ! Dans ces conditions, ce n’eat pas tant l’individu, que poursuivent les soi-disant réformateurs, que la classe elle-même, en tant que classe. Bourget et Drumont ne contestent pas que les grèves ont été aussi hostiles, aussi aveugles, aussi brutales, contre les bons patrons reconnus justes et bienveillants, que contre les mauvais. La haine est peut-être même plus vive, quand il s’agit d’un patron, sorti du rang. N’est-il pas d’ailleurs remarquable qu’ils ont une égale aversion pour leurs élus politique, justement parce que l'élection, sans autre raison qu’une faveur passa gère, en a fait des privilégiés, et les a in vestis d’un pouvoir quelconque, rarement justifié par le mérite ou le talent? Drumont cite encore là un fait typique, dans cette parole d'un des employés de son journal, qui était désespéré de la grève, et qui s’y soumettait cependant : — «Je suis de ma classe !» — Ce mot là résumait tout, pour lui, et comme sa classe n’avait pas ce qu’il considérait être son droit strict, il allait de l’avant avec les autres, peut-être moins haineux, plus hésitant, mais en somme inspiré par les mêmes doctrines. Un autre fait est encore à observer. Les grèves éclatent surtout, dans les profes sions les plus privilégiées, celles où les salaires sont vraiment rémunérateurs, où les chômages sont rares ou inconnus. Ce sont donc ceux qui, se rapprochent le plus du patronat ou des conditions d’ai sance du patronat, qui sont les plus exi geants. Quand on prend du galon, dit un proverbe populaire, on ne saurait trop en prendre ! On a voulu reprocher les classes, au nom de quelques idées abstraites et...
À propos
Fondé en 1845, le Mémorial judiciaire de la Loire est, comme son nom l’indique, un journal judiciaire. D’abord hebdomadaire puis quotidien, il est rebaptisé L’Avenir républicain en 1848, puis L’Industrie en 1852, puis le Mémorial de la Loire et de la Haute-Loire en 1854, nom qu’il raccourcit quelques quatre-vingt-ans plus tard en Le Mémorial. Collaborationniste, le journal est interdit en 1944.
Données de classification - drumont
- legagneux
- elena
- deherme
- posen
- leblanc
- blériot
- parseval
- guillaume ii
- berliner
- paris
- la loire
- bourget
- amiens
- neuilly-sur-seine
- toulon
- saint-étienne
- bretagne
- ur
- briot
- union postale
- krupp
- compagnie à
- parlement