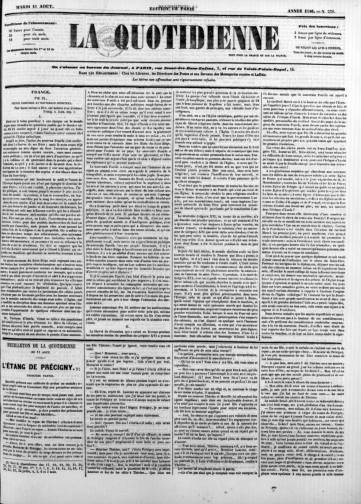Extrait du journal
la Gazette de s’expliquer sur le sens qu’elle attachait au serment, la Gazette lui fait aujourd’hui une réponse que nous reprodui sons pour plusieurs raisons. La première, c’est qu’ayant fait con naître la demande de l’Avenir , notre impartialité nous presçrit de faire connaître aussi la réponse de la Gazette. Cette réponse d’ailleurs prouve à quel point la conscience des royalistes est troublée par une demande de serment dont aucun honnête homme ne peut se dissimule*, ta gravité : elle montre aussi que les écrivains mêmes qui poncent les royalistes au ser ment, éprouvent en quelque sorte le besoin de se faire illusion sur la nature et sur la portée de cet acte qui, jusqu’à ce jour, avait été l’objet du respect de tous les peuples. « L'Avenir, qui engage tous les catholiques à faire le serment exigé pour des facultés et même pour des fonctions, nous de mande d’expliquer comment le serment prêté par des hommes de la droite peut, sans ressembler à des restrictions mentales, ne pas impliquer leurs opinions. » Remarquons d’abord, à l’hontieur des royalistes, que le ser ment n’est devenu une question que depuis la révolution de juillet. Jamais le parti libéral n’a vu d’objections au serment de mandé sous Louis XVIII et Charles X, et c’est seulement depuis le triomphe du libéralisme que les questions de conscience sont devenues des questions politiques. » L’explication que nous demande Y Avenir annonce que le ser ment esLune déviation des principes de3a Constitution, et que la révolution actuelle a jeté dans les esprits une confusion qui ne permet pas à beaucoup de Français de distinguer l’intérêt d’un parti de celui de la France. » Nous croyons exprimer une maxime vraie en disant que le serment ne peut être fait que dans le sens où il est demandé. Ainsi il faut donc savoir ce qu’ont entendu leshommes qui ont rendu ce serment obligatoire sous la nouvelle Constitution. » Ces hommes qui tous , depuis l’homme des centres jusqu’à l’homme de l’extrême gauche, ayant prêté serment de fidélité à Charles X, et d’obéissance à la Charte constitutionnelle et aux lois du royaume, n’en ont pas moins cru pouvoir renverser le roi, la Charte et la loi fondamentale de l’hérédité an trône , en arguant d’une violation de la Charte dont ils se sont faits juges eux-mêmes, ces hommes , disons-nous, ont-ils pu vouloir lier les électeurs et les députés autrement qu’ils ne s’étaient cru liés par un serment pareil ; c’est là ce qu’il est impossible d’admettre, surtout d’après un changement constitutif qui. p!ar !.i s uzeraineté dans le peuple, a subordonné la royauté à la volônté de tous les Français. » Cette royauté , postérieure au peuple actuel . peut-elle atta cher au serment qu’on lui prête les mêmes idées de foi et d’obéis sance que si elle avait été appelée au trône par un droit antérieur? Une telle prétention ne pourrait être avouée sans révolter les vain queurs de juillet qui entendent bien rester, par rapport à elle, dans la situation où ils étaient en la créant. » Le principe de l’hérédité qui a été introduit dans cette nou velle royauté par un acte législatif, reste nécessairement subor donné au consentement tacite ou formel du peuple qui ne sau rait se dépouiller lui-même, consentement dont les électeurs et les députés constituent le seul élément légal. » Que vient-on donc nous parler de restrictions mentales quand nous donnons au serment le sens qu’y doivent attacher ceux qui le demandent? Si ces hommes y attachaient un autre sens, s ils prétendaient lier les électeurs et les députés hors des conditions où la constitution les place, les engager envers un homme indé pendamment de leurs opinions sur ce qui convient le mieux à la France , ce seraient les demandeurs de serment qui feraient des restrictions mentales. Louis-Philippe s’est engagé lui-même par serment à agir en toutes choses dans les seules vues de l’intérêt , du bonheur et de la gloire du peuplefrançais. C’est dans les termes du serment du roi que doit s’entendre le serment des électeurs et des députés. » Au lieu de nous demander des explications , il nous semble que c’est au Moniteur qu’il faut les demander. » Que le journal officiel dise donc une fois pour toutes ce que la révolution entend par le serment attaché aux droits électoraux. » Si, par exemple, on entend que les électeurs promettent de nommer des députés qui placent l’intérêt du roi Louis-Philippe au-dessus des intérêts de la France, dans les questions où ces in térêts pourraient se trouver en opposition, des députés, qui dans de telles circonstances croyant f intérêt. le bonheur et la gloire du peuple français A ans d’autres conditions que les conditions ac tuelles, hésiteraient à le déclarer au prince et au peuple, aucun homme de la droite, et, nous disons plus, aucun homme de la gauche, s’il est conséquent avec lui-même, ne peut prêter un pa reil serment. » L’électeur et le député ne peuvent donc s’engager vis-à-vis du roi que dans les termes où le roi s’est engagé envers eux; l’intérêt de la France est le principe suprême du gouvernement et des ci toyens, et la conscience de chacun est juge de cet intérêt. » Si c’est là ce qu’entend le gouvernement, et il ne peut sans forfaiture entendre autre chose, comment donc y aurait-il une comédie dans un serment prêté dans ces termes par des hommes de quelque opinion qu’ils soient ? » Au reste, nous le répétons, c’est ainsi seulement que les hom mes de la droite qui ont prêté serment l’ont entendu, et avant que les élections commencent, il est bon, puisqu’on élève des dou tes, que le Moniteur s’expliqua sur ce point, car nous pouvons as surer que dans le dnuie les consciences royalistes s’abstiendraient,...
À propos
Publié d’abord sous le nom La Quotidienne en 1792, ce journal royaliste est l’organe principal de Joseph-François Michaud. Historien des croisades, ce dernier est d'abord républicain, puis devient royaliste par hostilité à la Convention. Ces revirements firent changer le journal de nom plusieurs fois durant la Révolution, l’Empire et la Restauration avant de retrouver, en 1814, son titre initial. En 1815, le journal devient la Feuille du jour.
Données de classification - charles x
- senot
- péri
- huder
- malcolm
- guilleminot
- argent
- codrington
- france
- dresde
- londres
- spithead
- suisse
- paris
- parker
- madrid
- siedlce
- russie
- banque de france
- conseil de guerre
- fribourg
- parti libéral
- république française
- mouvement populaire