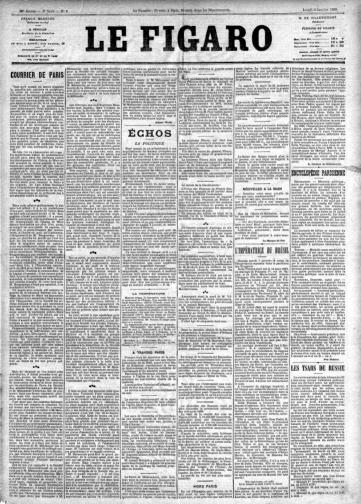Extrait du journal
Je ne puis vous dissimuler que je trouve assez cho quante la publication des lettres intimes écrites par Prosper Mérimée à une femme très distinguée qu'il aima passionnément. Mais, comme je n'y suis pour rien, je ne vois pas pourquoi j'hésiterais à profiter d'une indiscrétion que, par manière d'acquit, je réprouve, ni pourquoi je ferais scrupule de les lire, ces lettres où la tendresse est presque chiffrée, où la douleur, voilée, est si profonde et si décente. J'avoue qu'elles me procurent un plaisir de sur croît, qui est moins sévère. Je m'amuse bien, chaque fois que les chercheurs et les curieux m'apportent un nouveau témoignage de la sensibilité de ce Mérimée, réputé sec par tous les grands pleurards de son temps. Le vrai est qu'il est mort d'amour, ou à peu près, et que s'il a pu se prolonger quelques années ou quelques mois, c'est pour avoir planté, comme disait Sainte-Beuve, le clou d'or de l'amitié. Sécheresse et sensibilité sont les deux points sur lesquels le Français moyen a dit plus de bêtises à toutes les époques -de soft Histoire. Quiconque doute de raconter à très haute voix ses affaires de famille et d'expliquer son caractère dans les sdlles commu nes de restaurant, lui devient suspect de n'avoir ni cœur ni entrailles. Passe pour le Français moyen ; mais comment les familiers de Mérimée, qui n'a vaient pas cette vulgarité d'esprit, ont-ils pu mécon naître sa délicatesse toujours meurtrie et toujours blessée ? Le moins aveugle a écrit : « Pourquoi cet homme, qui est bon, fait-il tout ce qu'il peut pour paraître méchant ? » Jamais l'auteur de Carmen n'a rien fait pour paraître méchant, ni d'ailleurs pour paraître bon. Il était simplement bien élevé, et ne croyait pas devoir montrer son cœur à tout venant. Que cette pudeur est agréable, ou plu tôt cette éducation ! Mais elle est rare. J'ajoute qu'elle est dangereuse, à tous les degrés de la hiérar chie sociale. Dans les maisons ouvrières, on se méfie du soli taire qui ne parle pas volontiers à ses voisins, et qui n'entre pas matin ou soir, au moins une fois par jour, dans la loge, pour faire avec le concierge un brin de conversation. Cela ne tire pas à conséquence tant qu'il n'arrive rien dans l'immeuble ; mais qu'il s'y commette le moindre crime, la clameur publique aussitôt en accusera cet individu qui n'est pas cau sait,, et voilà, une nouvelle affàire Dreyfus ! On a ainsi envoyé au bagne, naguère, un innocent chi miste, convaincu par toutes les commères du quartier d'avoir incinéré plusieurs bonnes à tout faire dans un tout petit poêle en fonte, sur la grille duquel il avait peine à saisir une côtelette. Parlez au con cierge, c'est une précaution élémentaire. Elle est bonne à prendre même dans le plus grand monde, mais il faut ici entendre « concierge » au figuré. Lorsque j'étais au collège, et que je faisais des dissertations, souvent on nous donnait à déve lopper une remarque de La Bruyère ou une maxime de La Rochefoucauld : exercice, par parenthèse, inepte ; car on ne saurait plus sûrement fausser le goût des jeunes élèves qu'en les habituant à mettre en six pages ce qu'un grand écrivain a jugé à pro pos de mettre en deux lignes. Je me souviens d'avoir longuement bavardé sur cette réflexion connue : « Chacun dit du bien de son cœur, et personne n'en ose dire de son esprit. » Un critique des commencements du dix-neuvième siècle, Aimé Martin, dont le plus beau titre est d'avoir épousé la veuve de Bernardin de SaintPierre, observe que « cette maxime est vraie, mais que l'auteur s'est plu à la contredire dans le portrait qu'il a tracé de lui-même : « J'ai de l'esprit, ditil... et je suis peu sensible à la pitié. » Ce pauvre Aimé Martii^ n'y a rierç compris : La Rochefou cauld a traduit en terme? nobles, selon le styje du siècle, l'avis de parler au concierge ; mais il a, quant à lui, trop de hauteur dans le caractère pour daigner suivre le conseil qu'il donne aux gens de faible courage. Abel Hermant, de l'Académie française....
À propos
En 1854, quatorze ans après la disparition du petit journal subversif du temps de Charles X, Hippolyte de Villemessant relance Le Figaro. Paraissant d’abord sous la forme d’une petite feuille de chou littéraire, Le Figaro absorbe L’Événement en 1866 pour devenir, sans transition, le grand quotidien conservateur que l’on connaît. Dès les années 1880, il abandonne la cause du monarchisme pour adhérer aux principes républicains.
Données de classification - doumergue
- poincaré
- léon bérard
- briand
- stimson
- doumer
- mérimée
- margaux
- léon noël
- cathala
- france
- gao
- paris
- allemagne
- angleterre
- palerme
- genève
- londres
- lyon
- alle
- la république
- sénat
- parlement
- société des nations
- académie française
- maison dorée
- s. a.
- action française