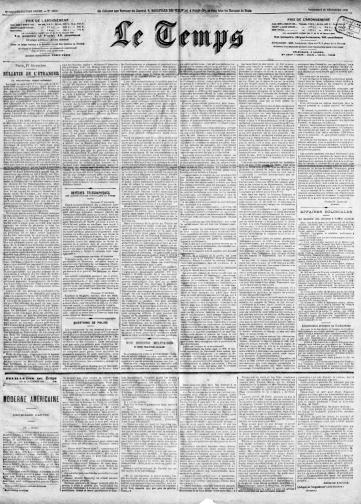Extrait du journal
français qu’on peut bien appeler le réservoir des forces physiques et morales de la nation? Ajoutez à cette première conséquence la dés organisation de la famille et la difficulté tou jours plus grande pour celle-ci de se propager et de durer. Ce sont les jeunes qui viennent à la ville, filles et garçons. Leur premier souci est de vivre, de trouver une place. Cette place leur suffit parfois; mais elle les enchaîne; en tout cas, elle ne suffît pas à l’entretien d’une famille. Le mariage et la: famille, qui sont une nécessité et une force relatives à la campagne, sont un luxe et une cause de misère à la ville. Donc on se marie moins. Chacun vit de son côté, a re cours aux expédients quotidiens; le cœur ne se développe pas ; ce que nos pères appelaient de ce beau mot où s’unissent la vigueur du sang et celle de l’âme, la « générosité » s’éteint, et un individualisme mauvais sans racines dans le ' passé, sans idéal et sans horizon dans l’avenir, dissout l’organisation sociale et réduit la cité elle-même à un monceau de grains de sable non agglutinés où le vent produit des. tourbil lons aussi stériles que violents. Ce n’est pas tout. Il faut compter avec la dé ception qui attend ces ruraux qui débarquent dans nos villes et y cherchent les moyens d’y vivre. Ils ont entendu parler de gros salaires. Mais ils n’ont pas compté sur la concurrence, sur les jours de chômage, sur la difficulté de se caser en sécurité. La surabondance même des bras qui s’offrent fait que beaucoup restent sans ouvrage. Si l’on fait, à la fin de l’année, la moyenne entre les jours où l’on a travaillé et ceux où l’on n’a l’ion eu à faire, il se trouve qu’on a encore moins gagné qu’au village. Là-bas on n’était pas riche sous le toit des aïeux; mais on vivait; le petit jardin fournissait les lé gumes; le champ, si maigre fût-il, donnait le pain qu’on mangeait l’hiver; on élevait une chèvre, quelques lapins, un cochon. La forêt voisine fournissait le bois ; les voi sins ôtaient des amis à qui l’on pouvait de mander un service et qui vous venaient en aide à l’occasion. On n’était pas seul, exilé, perdu dans un désert d’hommes. Voici la famille ve nue à Paris ou dans quelque autre grande ville. Elle se loge en deux pauvres mansardes ; elle épuise ses économies pour les meubler du strict nécessaire et passer les premiers temps à cher cher du travail. Il faut tout acheter très cher. Si la maladie survient, c’est la misère, une misère noire, désespérée, ignorée ; c’est la faim soli taire, c’est la mendicité anonyme avec toutes ses humiliations, et, une fois dans ce gouffre, impossible de le remonter et d’en jamais sortir. Ce qu’il y a peut-être de plus triste, en effet, que tout le reste, c’est qu’il est presque impos sible de sauver ces familles déchues et misé rables. Ayant quitté le village, elles ne veulent plus y revenir. En vain leur offre-t-on de les rapatrier ; elles résistent et préfèrent achever de s’éteindre. En venant à la ville, elles ont sou vent aliéné leur petit héritage. Qu’iraient-elles faire dans des lieux qui ne les reconnaîtraient plus? La honte les empêche d’y reparaître mi sérables. Enfin, elles se trompent elles-mêmes et, dans les jours de la plus grande détresse, aux offres de retour au pays elles répondent : « Non, non, dans quelques jours sans doute nos affaires iront mieux. » Cet accroissement inévitable des misérables dans les villes peut finir à son tour par rendre insuffisant et comme stérile tout ce que l’Assis tance publique s’ingénie à faire pour eux. Com ment ne pas signaler ici le cercle véritablement infernal où nous sommes pris et où il semble que nous sommes condamnés à périr? La mi sère des grandes villes est de plus en plus et toujours mieux soulagée. Ces villes font des sa crifices énormes soit pour venir au secours de ceux qui souffrent, soit pour rendre J’existence plus facile et plus agréable à ceux qui travail lent. Mais, en même temps, tous ces avantages amènent dans leurs murs un afflux toujours grossissant d’étrangers et de provinciaux qui viennent y chercher fortune, y rencontrent la misère et retombent à leur charge. Au lieu de progresser, la société tourne ainsi et piétine sur place. La misère stimule la générosité publique et celle-ci entretient et accroît la misère. Est-il donc impossible de trouver une issue à cette contradiction qui semble paralyser, par une iro nie fatale, tous nos efforts et jusqu’à l’espé rance ? En fait de remèdes à une telle situation, on n’en aperçoit que deux : le premier est celui qui peut et doit ressortir nécessairement du jeu des lois naturelles qui tendent toujours à ramener l’équilibre nécessaire. Un moment viendra, il est déjà venu pour les esprits attentifs, où le trop plein dans les villes dessinera forcément un retour vers lps campagnes. La vie, y deve nant moins facilé, y attirera moins d’émigrants et ceux-ci, instruits par de trop cruelles expé riences, cesseront d’en subir la fascination. Mais on aurait tort de trop compter sur cette némésis de la nature. Ce que nous apercevons très nettement, les paysans, moins instruits et plus éloignés des choses, ne l’aperçoivent point et restent victimes des mêmes illusions longtemps après que celles-ci n’ont plus aucune raison d’ôtre.il ne faut donc pas attendre qu’ils s’instruisenttoutseuls, qu’ils deviennent sages à leur dé pens. L’honneur de la destinée humaine, c’est de dépendre en partie de la volonté et de la sagesse de l’homme. Il faut donc joindre aux revanches des lois naturelles les leçons pratiques de la rai son, pour diminuer autantque possible les souf frances que de telles perturbations sociales amènent. Gouvernement, hommes politiques, éducateurs du peuple, simples citoyens doivent s’employer non seulement à prémunir les habi tants de"nos campagnes contre les mirages qui les séduisent, mais encore à les attacher plus fortement au sol natal. A ce point de vue, la po litique agricole est la vraie. Cela ne veut pas dire une politique aveuglément et sottement protectionniste, mais une politique pratique, intelligente, ayant toujours en vue de fortifier et de développer cette race de paysans français qui a toujours fait la force militaire et morale...
À propos
Le Temps, nommé en référence au célèbre Times anglais, fut fondé en 1861 par le journaliste Auguste Neffzer ; il en fit le grand organe libéral français. Il se distingue des autres publications par son grand format et son prix, trois fois plus élevé que les autres quotidiens populaires. Son tirage est bien inférieur à son audience, considérable, en particulier auprès des élites politiques et financières.
Données de classification - gilbert
- breslau
- rousseau
- de vollmar
- vollmar
- bebel
- liebknecht
- heritage
- atkins
- pall
- elma
- francfort
- angleterre
- allemagne
- privas
- atkins
- londres
- tananarive
- belgique
- finistère
- parti socialiste
- parlement
- union postale
- parti démocrate
- g. v.
- sénat