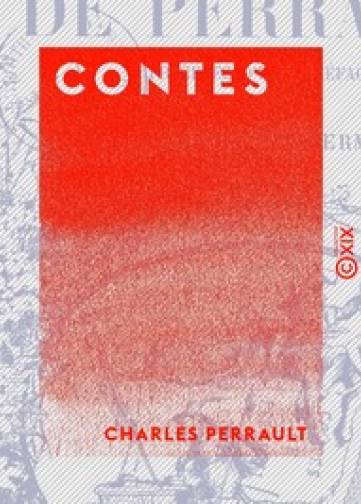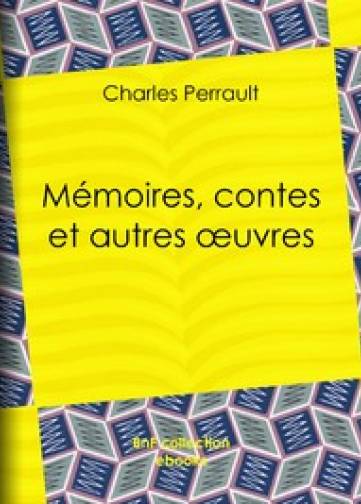Le conte de fées au XVIIIe : une histoire merveilleuse – et terrible
Le « conte de fées » a une histoire plus mouvementée qu’on ne pourrait le penser, et a été au siècle des Lumières un objet ambigu. Ses usages balançaient entre tradition et modernité, attribution populaire et création littéraire, outil social, voire arme politique.
Le conte de fées peut nous sembler un objet immobile, passé fidèlement de voix en voix de génération en génération. De fait, le conte oral présente parfois une constance remarquable, répété presqu’à l’identique à des milliers de kilomètres et à plusieurs siècles de distance. Mais, comme le montrent des études d’anthropologie historique précises, comme celle magistrale de Jean-Claude Schmitt sur la légende du « saint lévrier », le récit oral reste un matériau profondément changeant, qui est susceptible de se refaçonner très rapidement sous la main de l’histoire, selon les changements de contexte sociaux et culturels.
Cette observation est encore plus valable pour ce qu’on appelle le « conte de fées » à proprement parler. Avant de renvoyer de façon faussement évidente à une tradition rurale, populaire, immobile, qui nous vient avant tout du romantisme allemand, le « conte de fées » a d’abord une histoire littéraire, intimement liée à Charles Perrault, qui érigea une tradition orale (plus précisément, une partie de cette tradition) en genre littéraire.
La définition du conte et sa dénomination même n’ont rien de simple. Nous pouvons dire qu’il s’agit d’un récit dans lequel le merveilleux joue un rôle central. Il se trouve associé à la narration orale, particulièrement à celle destinée aux plus jeunes, comme le définissait le jésuite Crasset au milieu du XVIIe siècle : on parle avec dédain « d'un conte de Fées, c'est à dire d'une tradition fabuleuse dont on entretient les enfans ».
« Conte de fées » n’était par ailleurs qu’une expression parmi d’autres. Comme le rappelle une comédie en vers de 1665, on pouvait dire entre autres « conte borgne [,] conte à dormir debout [,] contes bleus [,] contes de vieille [,] contes pour rire [,] contes violets [,] vertdemers, ou de ma mere l'oye ». L’origine de ces expressions reste assez énigmatique. « Conte bleu », souvent utilisé jusqu’au XIXe siècle, a été assez vite rapproché de la bibliothèque bleue de Troyes (du nom de la couleur du papier bon marché utilisé), qui diffusait une littérature dite « populaire » de chansons de geste et de récits légendaires dans lesquels le merveilleux prenait part, comme Valentin et Orson, ou Les Quatre fils Aymon. De même, l’usage de « conte borgne » a été rapidement expliqué par le caractère socialement obscur des contes, comme l’on disait « cabaret borgne » pour signifier « mal fréquenté ».
Quelles que soient leurs origines, ces connotations sont dans l’ensemble socialement méprisantes : « de tels contes [bleus] peuvent très-bien amuser des paysans durant les longues soirées d'hiver [...] et ennuyer une Parisienne éclairée », dit un critique du Journal de Paris, bien plus tard dans le XVIIIe siècle.
Mais parallèlement, autour de 1690, le conte de fée en tant que genre littéraire fit son apparition, sous la plume de Marie-Catherine d’Aulnoy, qui inséra dans un de ses romans « un conte approchant de ceux des Fées ». Si les auteures femmes (dont Marie-Jeanne L' Héritier de Villandon, la nièce de Perrault) prennent une part essentielle dans la construction de ce type nouveau, sinon de récit, du moins de présentation et de publications, Perrault en devient bientôt la figure centrale. Il s’agissait bien de quelque chose de neuf, et c’est dans un journal, le Mercure galant, qu’apparaît ainsi la Belle au bois dormant sous sa plume, et qui est introduite ainsi :
« Quoy que les Contes des Fées et des Ogres semblent n'estre bons que pour les Enfans, je suis persuadé que la lecture de celuy que je vous envoye vous fera plaisir. »
Cela fut effectivement une réussite. Le nouveau genre se diffusa rapidement, devint une référence, et l’objet de discussions et de réappropriations.
Un objet littéraire nouveau, discuté et exploité
Ces auteurs avaient actualisé une forme ancestrale de narration, et le tour de force de Perrault fut de la mettre à contribution dans sa défense des « Modernes » contre les « Anciens ».
D’emblée, le conte de fées bousculait les genres, et n’obéissait pas à un modèle littéraire connu. Peut-être précisément pour cela, son succès fut remarquable, et davantage encore à partir des deux premières décennies du XVIIIe siècle, lorsqu’Antoine Galland traduisit et adapta l’immense corpus de contes indo-arabes, sous l’égide de Shéhérazade et le titre des Mille et une nuits. Le succès fut immédiat, et durable – le Mercure de France, un demi-siècle plus tard, n’hésitait pas à affirmer que l’ouvrage était « entre les mains de tous [ses] lecteurs ». Avec Galland, le goût pour l’Orient rejoignait celui des « contes de fées modernes », expression qui peut paraître paradoxale, mais utilisée tout naturellement par le même Mercure de France en 1765.
Cette « modernité » rend bien le caractère nouveau d’un genre qui n’était pas encore codifié, et qui pouvait déstabiliser. Non seulement le problème de la mode et de l’écriture des contes de fées est très amplement débattu en 1741 à l’Académie française par le (légèrement oublié) François-Augustin Paradis de Moncrif, mais la dissertation de ce dernier prend une bonne place (dix pages) dans le Mercure de France quelques mois plus tard. Il y explique que les « les Contes de Fées et d'Enchanteurs », tant à la mode, sont néanmoins « plus dénués d'imagination que beaucoup d'autres Ouvrages [...]. »
« Par imagination M. de M[oncrif] entend [... ] ce qu'on appelle Génie, idées neuves, ou du moins rendues d'une manière originale. »
Moncrif s’attaque ici à Jonathan Swift, son Gulliver ne valant guère plus qu’une page ; à Defoe, comme n’importe qui aurait pu écrire Robinson Crusoe ; et enfin aux contes de fées. Pour les écrire, « il n’est presque point besoin de penser », on peut le faire même « sans aucun esprit ». Il tâche de le prouver en faisant mine d’improviser un conte, pour montrer la vacuité de la plupart de ces productions – qui ne deviennent acceptables, ajoute-t-il, que lorsqu’ils contiennent « une ou plusieurs vérités propres à former les mœurs, ou à éclairer l'esprit en l'amusant ».
Dans cette moquerie assez acerbe des contes de fées, Moncrif avait de bonnes raisons pour laisser un petit espace pour ceux qui sont tout de même de qualité : il en écrivait lui-même. Pour se faire une idée du génie et des idées neuves qu’il y insuffla, on peut consulter le Divertissement qu’il composa en l’honneur de la naissance de l’héritier présomptif de Louis XV, où des fées se penchent sur l’enfant pour lui souhaiter un grand règne – malheureusement sans effet, puisque le jeune prince mourut à neuf ans, laissant la place à son frère, le futur Louis XVI.
Moncrif était bien représentatif de l’ambiguïté du conte de fées des Lumières : un certain mépris, une certaine hauteur, et une grande tentation. S’il n’est pas codifié de façon rigide, et s’il ne correspond pas aux canons littéraires de l’époque (la vraisemblance, le roman sous forme de mémoires, de lettres…), il n’en devient pas moins une référence particulièrement attractive, et l’objet de réappropriations multiples. Les contes sont mille fois déclinés. Dans le Mercure de France, les rimeurs s’exercent à donner de nouvelles versions d’un des récits, très légèrement osé, des Mille et une nuits, ou du Petit chaperon rouge « tiré des Contes de Fées de Perrault » :
« Il étoit autrefois une petite fille, [...]
Un petit chaperon composoit sa parure ;
Il étoit rouge, et cet ajustement
Lui convenoit si bien que jamais la nature
N'a rien produit de si charmant »
Le XVIIIe siècle voit également les contes récupérés par le théâtre. Dès 1735, le théâtre italien présente une pièce simplement intitulée « Le Conte de Fées », dans laquelle, nous indique le Mercure de France, on voit un véritable géant. Puis au tour de Cendrillon d'être adaptée en opéra-comique en 1759 ; et ainsi de suite.
La récupération la plus inattendue réside peut-être dans la rencontre improbable entre contes et libertinage – mais sans doute faut-il y voir une des déclinaisons de la liberté et de la souplesse qu’offrait le conte. Le Mercure de France toujours, en 1755, avertissait ainsi de la parution de La Baguette mystérieuse, une « féerie » située en Orient, dans laquelle la baguette joue le rôle bien connu de l’objet magique, « mais avec moins de modestie » (entendez : « pudeur ») : « elle a même un faux air de l'Ecumoire de Tanzaï ». Cette écumoire est celle d’un conte libertin de 1734 improbable et novateur, de Crébillon (fils), qui conduisit ce dernier à la Bastille. Crébillon s’y moque du conflit autour des jansénistes en matérialisant une bulle papale sous la forme d’une écumoire remplaçant le sexe du protagoniste – et dont il ne pourra se débarrasser qu’après l’avoir fait lécher, avaler, etc.
Diderot, qui s’était livré à l’exercice du conte libertin avec ses Bijoux indiscrets, c’est-à-dire des sexes féminins auxquels une bague magique donne le pouvoir de parler, ne paraît ainsi pas le plus inventif.
Ce dernier type de récupération illustre l’une des caractéristiques du conte au XVIIIe siècle : l’étendue exceptionnelle du spectre (artistique, social, thématique) sur lequel il est susceptible de glisser librement.
Les multiples gammes du conte : de la lie populaire au monde princier
Les connotations associées au conte, de son établissement en tant que genre jusqu’à la Révolution, naviguent de fait du licencieux au moral, de l’enfant à l’adulte, ou encore du populaire méprisé aux élites, lettrées ou politiques. Ici encore, la presse permet de sortir d’un seul répertoire (la littérature), de la seule théorie ou de la critique, et permet de mesurer les usages, étendus, du mot « conte ».
L’une des principales dimensions parmi ces connotations réside dans l’oscillation entre la dénonciation d’un danger des superstitions liées aux couches basses de la société, et une sorte de sublimation utilitariste du conte, qui emploierait le plaisir lié au récit merveilleux pour promouvoir une éducation susceptible de toucher toute la population. Ainsi, pour le danger : les phénomènes surnaturels ou préternaturels sont dédaigneusement renvoyés à ce genre, comme les « Esprits Folets qui ne peuvent être admis que dans quelques Contes de Fées » (Mercure de France, 1730).
Un long poème dans le même journal souligne cette opposition entre « superstition » et rationalisation : « Malgré les Contes bleux dont nous sommes bercez [sur les revenants], Je crains plus un Voleur que mille Trépassez ». Ce type de critique est socialement dirigé, et l’amalgame suivant, tiré d’une critique littéraire, est de ce point de vue très significatif :
« C’est un ramas de contes de vieilles, de superstitions folles, de goinfreries excessives & chimériques, de sentences usées, & d'injures & de proverbes des Halles. »
Le danger superstitieux lié aux origines du conte (les « vieilles » tantes, les nourrices, etc.), est rapidement contrebalancé par la pédagogie moralisatrice. On peut avoir de l’estime, indiquent les Observations sur les écrits modernes en 1735, pour « les Ouvrages, où, sous le voile d'une fiction badine et ingénieuse, régne une morale instructive ». C’est bien le cas pour quelques « nouveaux Contes de Fées », et le journal d'appuyer l'idée, qu'il présente comme nouvelle ou du moins inattendue, « qu’on trouve de solides moralités dans un Ouvrage d'un genre si frivole ».
En 1736, de Nouveaux contes allégoriques sont publiés dans cette veine, dans un ouvrage « où il y a de l'invention, de la délicatesse, de l'esprit, et du goût », affirment les mêmes Observations sur les écrits modernes. Le journal indique encore que la dimension « allégorique » n’apparaît pas seulement dans le titre : les contes sont parsemés de « réfléxions en petit nombre [qui] ne sont mises que pour aider le Lecteur à pénétrer le sens caché sous le voile de la fiction ».
Moncrif, toujours le même, explicite ce principe dans ses Essais sur la nécessité et les moyens de plaire, comme le rapporte le Mercure de France en 1738 : « les Idées [...] qui constituent chaque Conte [écrit et ajouté par Moncrif dans le même livre] servent à prouver l'utilité » des principes d'éducation défendus dans cet ouvrage.
De manière significative, et annonciatrice de l’évolution du conte vers la morale et la pédagogie, Moncrif construit un conte où les « dons des fées » à la naissance se révèlent inutiles, là où une éducation sans aide du merveilleux aboutit. Le Mercure résume cette trame :
« L'action consiste dans la conduite différente de deux Frères qui règnent sur un même Thrône.
L'un a reçu d'une Fée dès le berceau, l'Esprit, la Valeur et la Probité, et ce Prince abandonné à lui-même, et privé d'éducation, ne tire aucun avantage des Dons de la Fée [qui ne servirent] qu'à le rendre malheureux.
Le second Prince, secouru d'une éducation heureuse, acquiert toutes les qualités qui font un bon Maître et d'heureux Sujets. »
C’est bien là l’extrémité de cette logique pédagogique : le merveilleux, utile pour plaire mais qui continue à sentir le soufre, disparaît. Les « contes de vieilles » deviennent par exemple, au début du XIXe siècle, des « contes moraux de ma grand’tante », loués par Le Courrier des spectacles qui recommande également les contes de Berquin, où le surnaturel a entièrement disparu. Au milieu des années 1780, l’ex-jésuite Philippon de la Madeleine était allé encore plus loin dans ses Vues patriotiques sur l’Education du Peuple. Le Journal de Paris rapporta et diffusa ses idées :
« Il faut éloigner [des enfants] tout ce qui est dangereux, et même tout ce qui est inutile ; ces Contes de Fées ; cette Bibliothèque bleue [...] seront remplacés par des lectures solides, comme [...] les Moyens de rappeler les Asphyxiques et les Noyés à la vie. »
Autrement dit, retirez Peau-d’Âne des mains des enfants pour leur donner plutôt des imprimés indiquant comment réaliser l’insufflation anale de fumée de tabac, pratique phare de la réanimation des Lumières. Le Journal de Paris suit l’auteur dans ses a priori « patriotiques » et anti-philosophiques : l’ouvrage s’adresse aux monarques, car l’éducation du peuple, délaissée par le « Philosophe […] dans son cabinet » est primordiale. Le peuple : « Cette classe utile de Citoyens [...] fait la richesse, les révolutions, le sort politique des Etats ». Cette prédiction (nous sommes en 1784) est néanmoins immédiatement suivie par un rappel des valeurs de l’Ancien Régime :
« Il faut [...] une éducation au peuple ; mais une éducation faite pour les travaux auxquels il est destiné, pour la place que la Nature lui a assignée dans la société. »
Le peuple dépourvu de contes de fées serait à même de bien servir le roi et la cour... Dans les mêmes années, le jeu de célébration royale et de flatterie de cour par le conte de fées continuait. L’honorable professeur au Lycée Louis-le-Grand Nicolas-Joseph Sélis fit présenter à Marie-Antoinette par un jeune enfant son texte le « Prince Desiré, Conte de Fées », à l’occasion de la naissance du fils aîné de Louis XVI, Louis Joseph Xavier François de France. Nous sommes ici quelques mois après sa naissance. Le Mercure de France et le Journal de Paris louent l’auteur, et retranscrivent l’intégralité de ce conte qui contient « une allégorie ingénieuse », et qui commence peu heureusement par :
« Il étoit une fois un Roi et une Reine qui étoient bons, et que tout le monde aimoit. »
Après une longue attente, la reine (Marie-Antoinette) accouche d’un garçon. Le peuple est en liesse. « Les Génies et une Fée voisine arrivèrent pour douer le petit Prince » : il s’agit en fait des « ancêtres » de l’enfant (ses prédécesseurs plutôt), et l’on voit tour à tour défiler près du berceau saint Louis, François Ier, Henri IV… et même jusqu’à l’impératrice Marie-Thérèse d’Autriche, morte deux ans plus tôt, et qui aurait été sans doute étonnée de se voir représentée en fée. Les souhaits et les dons offerts par ces « génies » au Dauphin, sept ans avant la Révolution, sonnent doublement faux a posteriori : non seulement cet héritier présomptif de la couronne devait mourir prématurément, mais le régime même qu’il représentait était sur le point de s’écrouler.
Le conte et la Révolution : la radicalisation des rapports au réel
On a vu les récupérations multiples du conte de fées au cours du siècle des Lumières : il n’est pas surprenant que ses qualités ambiguës furent ensuite mises à contribution par la Révolution.
En 1784, Félicité de Genlis publiait ses Veillées du Château, ou Cours de Morale à l'usage des Enfans. Le Journal de Paris en fait la critique et résume les contes, dont celui intitulé Le Palais de la Vérité. « L'idée en est heureuse. Un Génie a répandu dans ce Palais un charme qui force les personnes qui s'y trouvent de dire, sans aucun déguisement, leurs plus secrètes pensées », et sans qu'ils ne s'en rendent compte. Six ans plus tard, l’enthousiaste révolutionnaire Jean-François de La Harpe reprenait le trait (Mercure de France, 23 janvier 1790) :
« Je suppose, comme nous l'avons vu dans quelques Contes de Fées, qu'il y eût une puissance surnaturelle qui pût forcer les hommes à proférer tout ce qui est au fond de leur cœur, de manière que leur pensée la plus secrète vînt, malgré eux, se placer sur leurs lèvres ; voici dans la plus exacte vérité, ce que les courtisans auroient dit au Roi toute la journée :
‘Sire, quand nous vous disons que votre pouvoir doit être absolu, illimité, au dessus de toutes les Loix, ce n'est pas que nous en croyions un mot ; nous savons bien que Dieu n'a donné à personne un pareil pouvoir [mais] il nous faut des richesses, des honneurs et du pouvoir [...] et nous voulons, comme de raison, envahir, usurper, dépouiller, insulter, opprimer, nous venger impunément...’ »
Le conte donnait le moyen de contourner la réalité pour mieux dire la réalité, la dévoiler. Ici, le monarque lui-même est relativement épargné – c’était encore le bon ton de 1790. C’est le Régime qui est attaqué, et l’on veut encore croire au roi révolutionnaire. Un an plus tard, les choses changent radicalement avec la fuite à Varennes. Le jour du retour du roi à Paris, le 25 juin 1791, à quatorze heures, au jardin du Palais Royal (un des centres d’attroupements spontanés des Parisiens pendant la Révolution), les discussions vont bien entendu bon train. La Feuille du jour, journal royaliste, en rapporte une :
« (C'est une femme qui pérore.)
Un homme [...] prend la parole : ‘Ce que nous voyons est incroyable ; je crois rêver ; je crois lire un conte de fées.’
La femme orateur : ‘Vous avez raison, monsieur, d'autant qu'ils commencent tous par ces mots : Il y avoit autrefois un roi, etc.’ »
La collision entre le monde des contes de fées et la réalité n’avait plus rien de l’innocence creuse des célébrations de naissances royales, et la violence des récits oraux allait être rattrapée par l’histoire révolutionnaire.
Quelques décennies plus tard, une autre image du conte s’imposera, issue du travail pionnier des frères Grimm et en résonance avec le romantisme allemand : le conte oral rural, issu d’un temps très long. Cette représentation n’est pas fondamentalement fausse. Mais l’histoire plus urbaine que nous avons ici entrevue n’est peut-être pas moins représentative de la nature ductile du conte. Une nature qui semble lui donner le pouvoir de s’emparer de tout matériau historique qu’il touche.
–
Pour en savoir plus :
J.-C. Schmitt, Le saint lévrier : Guinefort, guérisseur d'enfants depuis le XIIIe siècle, Flammarion, 1979
J. Courtès, « De la description à la spécificité du conte populaire merveilleux français », in : Ethnologie française, nouvelle série, t. II, no 1-2, pp. 9-42, 1972
T. Todorov, « Les hommes récits : Les Mille et Une Nuits » in : Poétique de la prose, coll. Points, Seuil, 1971
M. Soriano, Les Contes de Perrault, culture savante et traditions populaires, Gallimard, 1968
J. Barchilon, Le Conte merveilleux français (1690-1790), Champion, 1975
R. Robert, Le Conte de fées littéraire en France de la fin du XVIIe à la fin du XVIIIe siècle, Presses universitaires de Nancy, 1981
J.-P. Sermain, Le Conte de fées : du classicisme aux Lumières, Desjonquères, 2005
–
Anton Serdeczny est historien, docteur en histoire de l’EPHE. Il est l’auteur de Du tabac pour le mort, une histoire de la réanimation, paru aux éditions du Champ Vallon en 2018.