Archives de presse
La Guerre d’Espagne à la une, 1936-1939
Reportages, photo-journalisme, interviews et tribunes publiés à la une à découvrir dans une collection de journaux d'époque réimprimés en intégralité.
Pour accéder à l’ensemble des fonctionnalités de recherche et à tous les contenus éditoriaux, abonnez-vous dès aujourd’hui !
Pour accéder à l’ensemble des fonctionnalités de recherche et à tous les contenus éditoriaux, abonnez-vous dès aujourd’hui !

En 1937 et 38, la journaliste et écrivaine Simone Téry, fille d’Andrée Viollis, couvre les horreurs quotidiennes de l’Espagne en guerre – notamment pour L’Humanité et Regards. Ses descriptions hallucinées de la vie de tous les jours révèlent toute l’épouvante du conflit.
Absente des premiers mois du conflit, la célèbre reportrice Simone Téry (1897-1967) arrive en Espagne au début du mois de février 1937.
Ce n’est pas la première fois qu’elle pose le pied sur le sol espagnol : elle y est déjà allée au dernier trimestre 1934 pour rendre compte de la situation politique dans le pays, aux prises notamment avec la Révolution des Asturies. Elle y avait alors été arrêtée, alors qu’elle assistait à une réunion des Cortès (l’Assemblée nationale espagnole), suite à un article qu'elle venait de publier dans le quotidien libéral L'Œuvre.
Destinée à l'enseignement – elle est agrégée de Lettres – Simone Téry a été très vite rattrapée par son capital familial, fille de Gustave Téry (mort en 1928) et de la première grande reportrice du siècle, Andrée Viollis. Depuis une grosse dizaine d'années, elle a arpenté l'Irlande, la Chine, le Japon, les États-Unis, l'Allemagne, pour le compte de divers périodiques, dans lesquels elle a livré également des articles de commentaire. Dans ce milieu très fermé et très masculin des grands reporters, Simone Téry s'est fait un nom.

Archives de presse
La Guerre d’Espagne à la une, 1936-1939
Reportages, photo-journalisme, interviews et tribunes publiés à la une à découvrir dans une collection de journaux d'époque réimprimés en intégralité.
En 1937-1938, elle couvre la guerre d’Espagne principalement pour le compte de L’Humanité, l’organe quotidien du parti communiste, et de Regards, qui est lié à ce dernier. Simone Téry est en effet devenue, depuis 1935, membre du Parti.
Nombre de ses reportages seront d’ailleurs habités par sa phraséologie orthodoxe, certains friseront la propagande, mais le talent de sa plume n’y succombera pas tout le temps, loin s’en faut, pour le plus grand plaisir du lecteur d’aujourd’hui. Car Simone Téry manie les ressorts discursifs du reportage avec précision et élan, et le temps s’abolit lorsqu’on les lit : on est plongé dans la guerre d’Espagne. Précisons qu’elle signe aussi quelques reportages dans d’autres périodiques, dont L’Œuvre et l’hebdomadaire intellectuel du Front populaire Vendredi.
Peu de temps après son arrivée en Espagne, à l’instar de tous ses confrères depuis des mois, Téry est confrontée aux bombardements qui pilonnent Madrid.
Elle est frappée par l’atmosphère que prend la ville, soumise à une nuit obligée, ce sur quoi elle insiste dans plusieurs reportages. Dans l’un d’entre eux, publié dans L’Humanité le 30 mars 1937 et intitulé significativement « Madrid la nuit », elle relate sa pérégrination dans la ville :
« C’est une étrange sensation que de parcourir dans un noir absolu les rues désertées d’une capitale. Pas la moindre lueur aux fenêtres, pas le moindre lampadaire en veilleuse. Un silence surnaturel.
On n’entend que le bruit de ses pas dont l’écho se répercute, énorme, contre des murailles invisibles. On marche dans un rêve angoissant, on se croit dans une ville morte, on doute qu’elle sorte jamais de ce néant d’ombre, de silence. On se sent pareil à un esprit errant, dans un monde de fantômes.
J’ai heureusement pris la précaution d’emporter de Paris une lampe de poche, et j’essaye de m’orienter. »
Cette lampe de poche sera conviée dans d’autres articles, métaphore de la lumière qu’apporte au lecteur le reporter.
Simone Téry décrit avec force détails la destruction des immeubles, des maisons, devant lesquels elle bloque son regard, le 12 avril 1937 dans L’Œuvre : « Je ne puis détacher les yeux de ce décor hallucinant, de ces maisons coupées en deux, de ces poutrelles tordues sur le ciel comme des bras noirs. » Descriptions qu’elle réitèrera par exemple à Barcelone, en mars 1938, pour Regards, dans un reportage intitulé « Les heures tragiques de Barcelone sous les bombes ». Téry y indique par exemple qu’elle voit « un tapis ancien cloué entre deux assiettes persanes. […]. Une chambre au sixième restait suspendue au-dessus de l'abîme, accrochée à un mur fléchissant zébré de larges lézardes ».
Dans ce même numéro de Regards, c’est un bombardement de nuit que Téry a choisi d’évoquer. Elle montre ainsi que tous les instants du quotidien sont envahis par les alertes et combien les bombardements transforment le monde, rendant par exemple impossible de goûter à « cette tendre nuit de printemps » :
« Toute la ville dormait enfin d’un pesant sommeil lorsqu’à trois heures et demie une nouvelle alerte fut donnée. Et tout le monde se retrouva en bas, des manteaux hâtivement passés sur les chemises de nuit, les pyjamas.
À la lueur des lampes de poche on voyait les visages blêmes, les cheveux en désordre. Dehors la nuit était si claire qu’on distinguait à peine les minces faisceaux des projecteurs qui fouillaient le ciel. La lune ronde déclinait sur les toits. Et dans cette tendre nuit de printemps, les bombes assassinaient.
À cinq heures on se recouche. Et à huit heures ce ne fut pas la sirène mais les explosions qui jetèrent les dormeurs hors du lit. »
Cet extrait est aussi destiné à montrer que la reportrice s’est mêlée à la population, qu’elle vit comme elle, et ce, même si elle réside dans un hôtel. Par conséquent, comme la population espagnole, elle est soumise aux bombardements, elle les subit ; et peut y laisser sa vie. « J’ai vécu les heures tragiques de Barcelone sous les bombes par Simone Téry », indique la dernière page de ce numéro de Regards, avec une photographie pleine page probablement de cette dernière puisque nous avons pu recenser des mentions de ses clichés. Le je va prendre une importance décisive lors des évocations diverses des bombardements, d’autant plus quand le tragique de la mort va s’en emparer.
Ainsi le lecteur suit-il le cheminement de Téry à travers la ville, afin non seulement de permettre l’identification du lecteur au reporter mais aussi d’asseoir le statut de celui-ci comme étant au cœur de l’événement. Tous les détails dudit cheminement sont fournis, et le lecteur peut s’apercevoir qu’aucun espace n’est épargné par le déferlement destructeur :
« À deux heures moins cinq je quittai le café pour aller déjeuner à mon hôtel.
Je m'étais à peine assise devant la table que dans un fracas terrifiant la verrière de la salle à manger nous dégringola sur la tête. La pièce s'emplit d'une fumée jaune, suffocante, à odeur de soufre. La plupart des messieurs et des dames se retrouvèrent à plat ventre sur le tapis. La bombe avait dû tomber sur une maison voisine.
En effet, dans la rue étroite, à vingt mètres de là, la chaussée était jonchée de verre et de détritus, des femmes affolées couraient, des enfants dans les bras. Où couraient-elles, les malheureuses ? »
Bruit (« fracas » ; « dégringola »), odeur (« suffocante » ; « soufre »), visions de chaos : la reportrice convoque tous les sens pour que le lecteur ressente au plus près la scène. Laquelle est complétée par le mouvement des individus (« à plat ventre » ; « couraient ») desquels Téry s’est à ce moment-là dissociée. Elle subit le choc, l’odeur, mais cherche à regarder la scène pour mieux la saisir, la relater. Le travail du reporter doit prendre le dessus sur cette situation.
Autre façon de mettre en scène le danger auquel est soumis le reporter : « Je sors avec soulagement de cet antre, les tympans déchirés », écrit-elle dans L’Œuvre du 12 avril 1937. Dans l’édition de Vendredi parue le même jour, elle stipule, la brièveté des phrases ajoutant au sentiment de l’angoisse qui monte : « Le bruit des moteurs emplissait mes oreilles. Mes jambes tremblaient. » Le reporter peut ressentir de la peur et une souffrance physique : voici ce que Téry nous enseigne.
Les bombardements détruisent ; ils blessent également, ils tuent. Au fil de semaines, des mois, c’est l’évocation des massacres perpétrés par le camp fasciste, des victimes innocentes civiles qui va supplanter toute autre évocation. Aucun détail ne sera alors épargné au lecteur. Et la reportrice Simone Téry excellera à mettre en scène la difficulté de celui-ci à se confronter à la mort : « Je me forçai à suivre les civières à l’intérieur de l’hôpital », note-t-elle d’abord dans son article de Vendredi, intitulé « Madrid bombardé » et surtitré « Cité martyre ». Reportage où la description d’un mort revêt une importance fondamentale :
« Le grand blessé, lui, était bien tranquille. Il me regardait fixement, comme si j’avais été responsable. Le docteur s’approcha de lui, le palpa. L’autre ne bougeait pas. Alors le docteur lui saisit la paupière, toucha de son index la cornée de l’œil. Puis il lui prit le pouls.
– Il est mort, dit-il.
Il baissa rapidement les paupières, se tourna vers les autres blessés. Mais les paupières se relevèrent. Et le mort, le visage ensanglanté, continua à me regarder fixement. Il me tenait sous son regard. Je ne pouvais pas m’échapper.
Je sortis pour me remettre. »
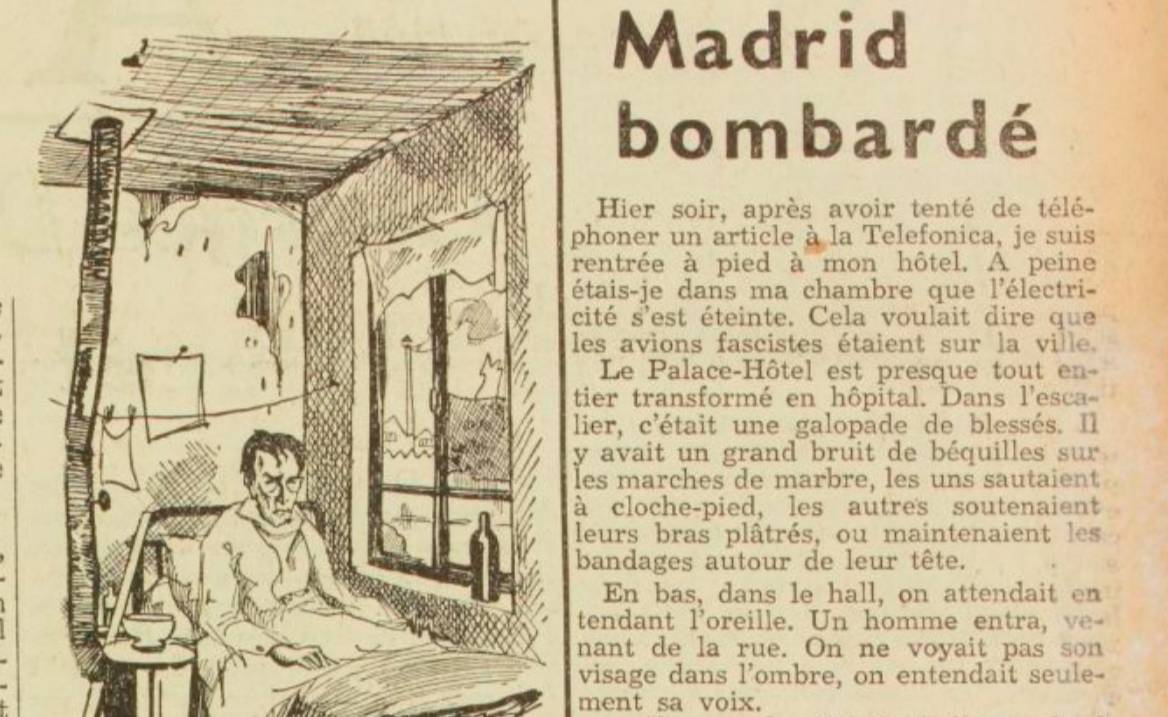
Cette évocation toute en tension repose entièrement sur le double regard du reporter et du mort. La reportrice ne peut le regarder (« je détournai les yeux ») moins parce qu’elle ne supporte pas sa vision que parce que lui la « regard[e] fixement comme si [elle] avai[t] été responsable ». Et regarder, ce n’est pas voir, c’est accentuer le regard qui continue même après la mort – puisque rien ne parvient à lui faire fermer les yeux.
Cette mise en scène sert à notre sens à deux questionnements. Le premier, le plus évident, interroge la responsabilité des autres pays, et particulièrement de la France dont Téry est ressortissante. Le « visage ensanglanté […] regard[e] fixement » la France qui « détourn[e] les yeux »… On peut envisager un second questionnement, non antinomique avec le premier : la difficulté de ce métier. Que faites-vous pour empêcher cela, semble dire aussi ce mort à la reportrice ? Nous allons y revenir.
Aucun détail ne sera épargné au lecteur, mentionnions-nous plus haut. Nombre de reporters se rendent dans les morgues. La République espagnole veut montrer au monde les victimes causées par les bombardements : elle veut choquer, émouvoir, dénoncer, et les reporters antifascistes sont les artisans – volontaires – de ce processus. Le lecteur a la possibilité de participer à l’une de ces visites, avec Simone Téry, le 1er avril, dans le troisième numéro de l’organe de la C.G.T., Messidor. Il offre à sa Une un cliché de destructions, au-dessous duquel se détache en lettres rouges – rappel de la couleur du titre du périodique – l’annonce suivante : « Devant les morts de Barcelone, par Simone Téry. »
« Je suis arrivée devant la porte en serrant les dents. Il fallait descendre quelques marches, c’était dans le sous-sol. Je ne pouvais me résoudre à y aller. » Cet incipit du reportage met d’emblée en scène le je de la reportrice, sa difficulté à effectuer son travail, son « devoir professionnel », comme elle le nomme dans un de ses articles. Et la lecture de ce reportage est difficilement soutenable, tant la description des cadavres y est minutieuse, quasi-clinique.
Ce devoir professionnel, elle en fera preuve également par la publication d’un recueil de ses articles publiés en Espagne – mais pas toujours identiques à leur parution dans les périodiques –, Front de la liberté. Espagne 1937-1938 (Editions Sociales Internationales). Si cette pratique d’anthologie est courante dans l’entre-deux-guerres, elle revêt une autre dimension pour le reporter engagé, qui plus est militant. Celle certes de toucher un public plus large ; mais surtout celle de conserver dans un livre les traces de ce qu’il a vu, pour des dénonciations futures.
Quelque temps après, Téry livre des reportages au quotidien communiste Ce soir, durant le mois de février 1939, où elle est principalement à Valence. Elle est donc loin de l’autre drame qui se joue de l’autre côté des Pyrénées, dans les camps d’internement du Sud de la France où sont parqués des Espagnols en proie au froid, à la faim, à la maladie. Mais elle en parlera, plus tard.
Car l’Espagne ne la quittera pas de sitôt. Le 18 mars 1937, dans Regards, relatant l’exode des habitants de Malaga sous des pluies de bombes – reportage illustré par des photographies de Robert Capa et de Gerda Taro –, elle réfléchissait :
« Comment dire ces choses ? Il faudrait le recul du temps. L’histoire les dira. Pour nous, nous ne pouvons que répéter, comme dans les cauchemars : “Non, ce n’est pas vrai… Ce n’est pas possible…”
Et pourtant, cela fut. »
Le 15 juin 1940, elle prendra le bateau pour le Mexique avec son époux l’écrivain espagnol Juan Chabas. Elle y écrira son troisième roman, Où l’aube se lève, publié aux Etats-Unis en 1945, qui reparaîtra en 1947 sous le titre La Porte du soleil.
Téry y injectera ses reportages, lui offrant ainsi des pages bouleversantes qu’il n’aurait pas comporté sinon. Car pendant la guerre d’Espagne, la reportrice avait réussi à « dire ces choses », à transcrire l’ineffable, l’horreur, le drame, le tragique. La marque des grands.
–
Anne Mathieu est maîtresse de conférences habilitée à diriger des recherches à l’université de Lorraine, à Nancy. Elle dirige la revue Aden et le site internet Reportersetcie, au sujet des intellectuels et journalistes antifascistes français et étrangers avant et pendant la Guerre d’Espagne. Son dernier ouvrage : Nous n'oublierons pas les poings levés - Reporters, éditorialistes et commentateurs antifascistes pendant la guerre d'Espagne (Syllepse, 2021).