Archives de presse
1871, la Commune
Une collection de journaux réimprimés en intégralité pour revivre la Commune à travers la presse de l'époque : caricatures, textes engagés, témoignages.
Pour accéder à l’ensemble des fonctionnalités de recherche et à tous les contenus éditoriaux, abonnez-vous dès aujourd’hui !
Pour accéder à l’ensemble des fonctionnalités de recherche et à tous les contenus éditoriaux, abonnez-vous dès aujourd’hui !

En 1871, le peintre Gustave Courbet participe à la Commune de Paris, dont il devient délégué aux Beaux-Arts. Accusé à tort d'avoir ordonné la démolition de la colonne Vendôme, il sera jugé et condamné à la prison.
Le peintre Gustave Courbet détestait les honneurs. Surtout venant d'un régime qu'en républicain farouche, il abhorrait : lorsqu'en 1870 Napoléon III veut lui décerner la Légion d'honneur, il la refuse dans une lettre ouverte qui paraît le 24 juin dans Le Siècle :
« J'ai cinquante ans et j'ai toujours vécu libre. Laissez-moi terminer mon existence libre ; quand je serai mort, il faudra qu'on dise de moi : Celui-là n'a jamais appartenu à aucune école, à aucune église, à aucune institution, à aucune académie, surtout à aucun régime, si ce n'est le régime de la liberté. »
Deux mois plus tard, après la bataille de Sedan, le Second Empire s'écroule : la République est proclamée le 4 septembre. Le 6 septembre, alors que les Prussiens sont aux portes de Paris, Courbet est nommé par une délégation des artistes de Paris « président de la surveillance générale des musées français ».
C'est à ce titre que le peintre propose de « déboulonner la colonne Vendôme », monument parisien érigé par Napoléon en 1810 sur la place du même nom afin de commémorer la bataille d'Austerlitz. Courbet considère en effet la colonne Vendôme comme un symbole odieux des malheurs de la France – mais il précisera qu'il souhaite seulement voir la colonne déplacée aux Invalides. La proposition n'a pas de suite. Mais elle lui coûte très cher l'année suivante.
Le 18 mars 1871, en effet, Courbet prend part avec enthousiasme à la Commune de Paris. Le 16 avril, il est élu au Conseil de la Commune par le 6e arrondissement et devient délégué aux Beaux-Arts. La presse versaillaise lui tire dessus à boulets rouges, à l'image du célèbre Francisque Sarcey dans Le Gaulois du 17 avril qui titre ironiquement « Bonjour, M. Courbet » :
« Vous payerez peut-être fort cher les folies de ce triste et grotesque carnaval. Vous ne serez plus ni roi, ni président, ni rien. Vous ne serez plus que Courbet, et Courbet sans talent.
Bonsoir, monsieur Courbet, bonsoir ! »
Depuis sa nouvelle position, Courbet prend en effet des mesures afin de protéger les œuvres d'art du palais du Louvre, ainsi que d'autres lieux parisiens. Mais il n'a aucune part dans la décision prise par la Commune le 12 avril (quatre jours avant son élection) de détruire la colonne Vendôme. Cette dernière sera en effet démolie le 16 mai, en présence du peintre.
L'artiste démissionne de ses fonctions le 24 mai, en pleine Semaine sanglante, afin de protester contre l'exécution de son ami Gustave Chaudey. Le 1er juin, la presse annonce sa mort :
« Pris dans les premiers jours de la semaine, il avait été emmené à Versailles en même temps qu'un certain nombre d'insurgés d'un rang inférieur.
M. Gustave Courbet, on le sait, était très gros ; fatigué, épuisé déjà avant de se mettre en route, il n'avait pu faire le chemin qu'avec la plus grande difficulté. Arrivé à Satory, il voulut à toute force qu'on lui donnât à boire ; il avait chaud.
Il résulta de cette imprudence une sorte d'apoplexie qui l'emporta au bout de quelques heures. »
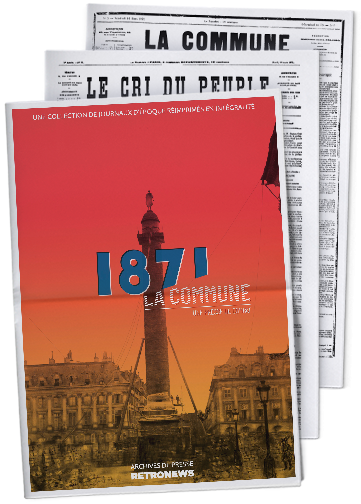
Archives de presse
1871, la Commune
Une collection de journaux réimprimés en intégralité pour revivre la Commune à travers la presse de l'époque : caricatures, textes engagés, témoignages.
En réalité, Courbet a simplement été arrêté. Il est enfermé à la Conciergerie, puis à Mazas. Lorsqu'on apprend qu'il est toujours vivant, la responsabilité de la destruction de la colonne Vendôme, qui a tant scandalisé les Versaillais, lui est immédiatement imputée. La presse publie le 11 juin un compte-rendu, sans doute très romancé, de son arrestation puis de son interrogatoire :
« Le promoteur de la démolition de la colonne Vendôme, Courbet, a été définitivement arrêté, avant-hier soir, dans une maison de sinistre apparence, située rue Saint-Gilles, n°7 [...]. Quelques minutes après son arrivée au dépôt, M. Bérillon, commissaire de police du Palais de Justice, se transportait au parloir et commençait l'interrogatoire du prévenu […].
– Pourquoi avez-vous provoqué la démolition de la colonne Vendôme ?
– Que voulez-vous, c'est plus fort que moi... la haine contre ce monument barbare m'aveuglait, mais je n'ai signé aucun acte contre le gouvernement de l'Assemblée nationale.
S'ensuit un long feuilleton judiciaire, que la presse va retranscrire. Courbet est jugé à Versailles à partir du 14 août, avec quinze autres communards et deux membres du Comité central. Il se défend en clamant avoir voulu protéger les œuvres d'art parisiennes et en niant toute implication dans la destruction de la colonne Vendôme.
« M. LE PRÉSIDENT, à l'accusé Courbet : À quelle époque êtes-vous entré à la Commune ?
COURBET : Le 26 avril […]. J'ai été envoyé là pour pacifier. Je croyais de mon devoir de le faire, ayant une autorité suffisante, du moins je le pensais, pour accomplir la mission que j'avais entreprise et qui m'avait été donnée le 4 septembre.
M. LE PRÉSIDENT : La pacification, après les décrets, n'était guère possible.
COURBET : J'ai fait ce que j'ai pu [...]. J'avais, en effet, une responsabilité immense. J'avais à sauver tous les objets d'arts qui occupent non seulement la France, mais l'Europe [...].
M. LE PRÉSIDENT : Vous avez réclamé l'exécution du décret sur la démolition de la colonne Vendôme.
COURBET : C'est une erreur […]. C'est moi qui ai proposé de conserver le soubassement de la colonne avec les panneaux qui représentent les anciennes guerres de la République. »
Le 2 septembre, le peintre est condamné à six mois de prison fermes et 500 francs d'amende, pour « complicité de destruction des monuments publics ». Une sentence jugée trop légère par toute une partie de la presse, à l'instar de La France qui écrit :
« Ainsi donc, faire partie d’un gouvernement insurrectionnel, dans des circonstances où le gouvernement déchirait le cœur de la patrie, mutilée par l’étranger ; prendre part à ses délibérations, lui apporter son concours, sa notoriété, son influence, semble n’être qu’une chose en soi indifférente [...].
Voilà le fait que le jugement d'hier met dans une pleine lumière. Après les désastres irréparables accumulés par la Commune, la conscience publique sera douloureusement émue par cette révélation. »
Courbet peint de nombreuses natures mortes pendant son séjour en prison. Le Petit Journal retranscrit la visite que lui fait un de ses amis peintres dans sa cellule, en novembre :
« Depuis trois jours seulement Courbet est en possession de ses pinceaux, de sa palette et de ses couleurs. Il avait demandé au général Valentin l'autorisation de faire une vue de Paris à vol d'oiseau des combles de Sainte-Pélagie.
“J'aurais peint cela, disait-il à son ami, dans le genre de mes marines, avec un ciel d'une profondeur immense, Paris avec ses monuments, ses maisons, ses dômes simulant les vagues tumultueuses de l'Océan. Malheureusement l'autorisation m'a été refusée, sous prétexte que je n'étais pas ici pour m'amuser.”
Et il ajoutait : “Le local que j'occupe est trop peu spacieux pour me permettre de travailler de souvenir, moi qui ne suis qu'un copiste plus ou moins exact de la nature, quand elle veut bien se montrer à moi sous ses aspects différents.”
Le fait est que, si Courbet est un méchant politique, il n'en est pas moins un des peintres les plus remarquables de ce temps […]. Parbleu ! Mais aussi qu'allait-il donc faire dans cette galère de la Commune ? »
À sa sortie, sa participation à la Commune lui vaut de violentes critiques. Comme le raconte Paul Lidsky dans Les Écrivains contre la Commune (1970), Alexandre Dumas fils écrit ainsi à son propos :
« De quel accouplement fabuleux d'une limace et d'un paon, de quelles antithèses génésiaques, de quel suintement sébacé peut avoir été générée cette chose qu'on appelle Gustave Courbet ?
Sous quelle cloche, à l'aide de quel fumier, par suite de quelle mixture de vin, de bière, de mucus corrosif et d'œdème flatulent a pu pousser cette courge sonore et poilue, ce ventre esthétique, incarnation du Moi imbécile et impuissant ? »
Sa carrière est brisée. D'autant qu'en mai 1873, le président de la République Mac-Mahon obtient de faire reconstruire la colonne Vendôme aux frais du peintre : 323 000 francs.
Mais Courbet n'aura pas le temps de payer. Exilé en Suisse, il y meurt, épuisé et malade du foie, le 31 décembre 1877. Il avait refusé de retourner en France tant que l'amnistie générale des Communards ne serait pas prononcée.
Au lendemain de sa mort, la plupart des journaux évoquent encore, souvent avec dureté, l'affaire de la colonne Vendôme – oubliant que l'auteur d'Un enterrement à Ornans, des Demoiselles du bord de Seine et de L'Origine du monde avait été l'un des plus grands peintres de tout le XIXe siècle.
–
Pour en savoir plus :
Michel Ragon, Courbet, peintre de la liberté, Fayard, 2004
Fabrice Masanès, Gustave Courbet, biographie, Taschen, 2006
Linda Nochlin, Courbet, Thames & Hudson, 2007