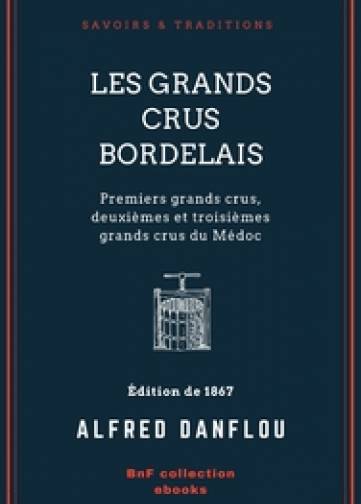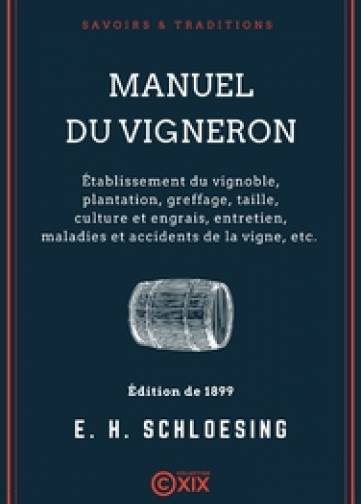De la piquette à l’absinthe : vin et alcools au tournant des XIXe et XXe siècles
Discussion avec l’historien Stéphane Le Bras autour des consommations d’alcool en France à la Belle Époque, reflets des divisions sociales, culturelles et géographiques d’un pays qui lève le coude.
Stéphane Le Bras est historien, maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université Clermont-Auvergne, spécialiste des pratiques et des représentations des boissons alcoolisées en France. Sa thèse, soutenue en 2013 et publiée en 2019 aux Presses universitaires François-Rabelais à Tours, porte sur le négoce du vin en Languedoc au XXe siècle. Elle vient de recevoir le Prix international du livre d’histoire de l’année par l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV).
Propos recueillis par Benoît Collas
–
RetroNews : Tout d’abord, au XIXe siècle, quelles sont les différences majeures de consommation d’alcool entre les régions ? Le vin est-il largement consommé dans toute la France, ou bien limité à certaines aires ?
Stéphane Le Bras : Effectivement, chaque région a un type de consommation presque local, lié à la production agricole dominante. En Normandie par exemple, on produit différents types de boissons alcoolisées avec les pommes : le cidre, modérément alcoolisé, ou le calvados, un spiritueux, plus fort. Plus globalement, il y a la bière au Nord et à l’Est, le cidre dans toute une partie ouest de la France, et le vin qui est très consommé partout en France.
Pendant longtemps, on a pensé que c’était la Première Guerre mondiale qui avait démocratisé le vin à l’ensemble des Français, mais en fait on voit très bien au XIXe siècle que le vin est déjà consommé dans toutes les régions. Néanmoins, dans celles où existent de fortes traditions de boissons alcoolisées dites « de table » – que l’on boit lors des repas –, le vin est concurrencé par ces dernières. Mais il est net que le vin est bu par une majorité de Français à partir des années 1850, notamment dans les centres urbains en plein développement.
Retrouve-t-on de façon nette les hiérarchies sociales dans les habitudes de consommation d’alcool ?
Bien évidemment, il y a une différenciation selon les classes sociales. Ce qu’il faut préciser, c’est qu’il y a également une différenciation selon les moments : les factures d’achats de familles bourgeoises parisiennes témoignent qu’elles achètent des bons vins plutôt le dimanche et pour des occasions particulières, mais boivent quotidiennement du vin de consommation courante. Il en est de même, à leur échelle, pour les classes populaires. La différenciation sociale va se faire aussi et surtout sur l’acte de boire en lui-même : la manière, le contenant, le lieu, etc.
Toutefois, il existe de nettes distinctions entre les classes sociales, avec des classes populaires qui se procurent des boissons alcoolisées à faible coût. La « piquette » est très représentative de ces différences : fabriquée en « mouillant » les lies et marcs – restes des vendanges après pressurage –, la piquette est peu sucrée et peu chargée en alcool (environ 4-5 degrés). Elle s’inscrit dans la catégorie plus large des boissons de ménage, produites à partir de divers fruits. Car encore au XIXe siècle, dans une France majoritairement rurale, l’autoproduction est très importante, dans tous les types de production de boissons alcoolisées. Ce phénomène est problématique pour l’historien car il est quasiment impossible de le quantifier – pour le vin par exemple, il faut ajouter entre 20 et 30 % d’autoproduction aux déclarations officielles.
Nous avons bien souvent l’image d’une consommation d’alcool – et notamment de vin – quotidienne et très élevée, tant au sein des classes populaires que des élites. Qu’en est-il réellement ?
Ce qu’il est primordial de comprendre, c’est qu’au XIXe siècle – et ce jusqu’aux années 1950-60 avec des effets presque encore aujourd’hui – on divise les boissons alcoolisées en deux : « boissons hygiéniques » et « alcools ». Le vin, le cidre, la bière ne sont pas perçus comme de l’alcool : on va en boire à tous les repas car elles sont considérées comme bonnes pour la santé – d’où leur nom d’ « hygiéniques » –, à une époque où il y a encore une très forte méfiance envers l'eau qui est souvent contaminée par des déchets, résidus animaux ou humains, produits divers et variés, etc.
Cela explique qu’un Français consomme en moyenne jusqu’à 150 litres d’alcool par an. Mais ces données statistiques sont à nuancer car elles sont par nature artificielles. Dans la réalité, de la fin du XIXe à la première moitié du XXe siècle, on peut considérer une moyenne d’un litre de vin par jour pour un homme adulte ; et jusqu’aux années 1980, il y a encore une majorité d’hommes qui ouvrent une bouteille une fois par jour.
Mais le vin du XIXe siècle est incomparable à celui que nous buvons aujourd’hui. Jusqu’aux années 1950, il ne titre pas plus de 10°, souvent moins, et il est, selon les habitudes, souvent coupé avec de l’eau, pour en faire une boisson consommée toute la journée (on parle de « boisson de soif »). La donne change après la Seconde Guerre mondiale. Les Français, en raison des pénuries, se sont habitués aux vins algériens, beaucoup plus forts grâce au climat. On voit alors se généraliser des vins de consommation courante qui titrent 11-12°, ce qui constitue un changement important.
Concernant la qualité du vin, comment émerge et évolue la distinction entre « grands crus » et vins ordinaires ?
La notion de grand cru est construite sur le temps long : si le concept de cru apparaît dès le Moyen Âge, celle de grand cru émerge au XVIIe siècle, se développe au XVIIIe et est institutionnalisée au XIXe, notamment avec le classement des grands crus de Bordeaux en 1855. Mais les grands crus représentent une quantité infime de la production et de la consommation. La distinction est au départ très binaire : grands crus et vins ordinaires, et ensuite se construit progressivement une complexification du marché par le biais de la labellisation (appellations simples, appellations d’origine, vins délimités de qualité supérieure, etc.).
Ce qui est primordial à prendre en considération dans cette logique, c’est que le goût est une construction sociale, dépendant de facteurs tant culturels que neurologiques. Citons deux exemples pour illustrer cela : le concours de Paris et l’association mets-vins. En 1976, le « Jugement de Paris » réunit, pour une dégustation à l’aveugle, onze personnalités du monde du vin, chargées de noter des vins français et californiens, goûtés de manière anonyme : la victoire de crus américains, tant dans les blancs que les rouges, engendre alors polémique (sur la scientificité de l’expérience) et scandale, ainsi qu’un engouement marqué pour les vins américains et ceux du « nouveau monde ».
Quant à l’association mets-vins, elle ne coule pas de source : il s’agit d’une norme imposée qui s’établit dans les années 1920-30, notamment via des livres prescripteurs édités par les deux grands marchands de vin de l’époque, Nicolas et Félix Potin. Par la suite, l’ensemble des acteurs commerciaux font de même : chez Casino dans les années 1950-1960, les gérants sont formés à cet égard et ils distribuent à leurs clients de petits fascicules qui indiquent quel vin boire avec quel aliment.
La distinction des vignobles, qui nous semble aller de soi aujourd’hui, existe-t-elle déjà au XIXe siècle ?
Avant la fin du XIXe siècle, on produit du vin partout en France, sur l’ensemble du territoire. Si l’on trouve déjà des typicités régionales dues au climat et au sol, on pratique massivement des assemblages, qui permettent de remonter les vins trop faiblement alcoolisés ou trop clairs de certaines régions. À cet égard, il est certain que l’humain joue le rôle le plus important dans l’élaboration du vin, et que le concept de « vin naturel » reste à nuancer.
Pour en revenir à la spécialisation des aires viticoles dans la seconde moitié du XIXe siècle, elle est due à deux facteurs : d’une part la révolution des transports qui permet d’acheminer des quantités de vin de plus en plus importantes, et d’autre part toutes les maladies cryptogamiques, le phylloxéra notamment, qui se répand par taches dans toute la France des années 1870 à 1900 et fait dépérir la vigne, et donc chuter drastiquement la production (34 millions d’hectolitres en moyenne par année dans les années 1880-90, contre plus de 50 millions dans les décennies précédentes).
Le phylloxéra a pour effet la rationalisation du marché, avec le Languedoc qui devient le cellier ou le chai des vins de consommation courante de tout le pays. On passe alors d’un type de vignes artisanal à un type de vignes industriel. Dans les espaces où le vignoble ne jouait qu’un rôle d’appoint, il disparaît. Le vin est dans le même temps légalement défini par la loi Griffe en 1889 en cette période de rationalisation où le marché, jusque-là libéral, est structuré par l’État suite aux fraudes massives de la période du phylloxéra : on produit des vins à partir de raisins secs par exemple, pour compenser le manque dû à la chute de la production.
Cette rationalisation du marché passe également par une modernisation, notamment de ses structures de distribution. Cela explique que les négociants, sur lesquels j’ai travaillé, connaissent au long du XXe siècle de profondes mutations, jusqu’à disparaître ou presque des circuits commerciaux quand l’État, associé aux groupes de la grande distribution, cherche à limiter le nombre d’intermédiaires dans les années 1960.
Comment évoluent les consommations d’alcools au tournant des XIXe et XXe siècles ?
L’évolution majeure de la consommation des alcools en France à cette période est la consommation d’absinthe. À l’origine remède contre le paludisme pour les militaires dans les régions chaudes (notamment en Algérie dans les années 1830-40), l’absinthe devient populaire en métropole dans la seconde moitié du XIXe siècle. Dans un premier temps, c’est une boisson de qualité et chère, donc réservée aux élites. En raison de son succès, la demande augmente : se développent alors des systèmes de production quasi industriels, écoulant de plus en plus d’absinthe.
À partir des années 1880-90, cette absinthe industrielle de mauvaise qualité est devenue majoritaire, inondant les zincs des débits où il s’en écoule des millions de litres dans les années 1900. Le lieu commun du « verre d’absinthe moins cher qu’un verre de vin » est à relativiser car à qualité égale, l’absinthe est toujours plus chère que le vin, mais on trouve néanmoins les mauvaises à très bon marché (15 centimes le verre dans les années 1890). L’absinthe devient alors, dans un contexte où une autre mode s’installe, celle de « l’apéritif », l’alcool star de la période, avec un véritable rituel. Logiquement, cet alcool devient alors la cible principale du mouvement antialcoolique au tournant des XIXe et XXe siècles.
Cette lutte contre l’alcoolisme est-elle d’ailleurs véritablement efficace ?
Le concept d’alcoolisme chronique est développé au tournant des années 1850 par un médecin suédois, Magnus Huss, et la notion est alors bien répandue dans les milieux hygiénistes et médicaux français dans les années 1860. Le mouvement antialcoolique, qui se développe à compter des années 1870, est un mouvement composé d’associations de notables – médecins, députés, etc. S’il dispose de relais efficaces dans la presse ou le monde politique, son efficacité est relativement faible dans la population, comme en témoignent les chiffres de consommation qui sont en constante croissance. Et même si le mouvement ouvrier se joint à la lutte antialcoolique dans les années 1890, les résultats sont relativement maigres, notamment face aux groupes de pression alcooliers.
Une grande victoire est toutefois l’interdiction de l’absinthe. Devenue cible principale des antialcooliques dans les années 1880, elle est interdite en 1915. Contrairement à une croyance répandue, ce n’est pas dû aux pressions du lobby viticole : les sources indiquent bien que c’est le mouvement antialcoolique, à l’instar de ce qui s’est déjà passé en Belgique et en Suisse (où il n’existe pas de lobby viticole), qui réussit à faire interdire l’absinthe, profitant de la chape morale du contexte de la guerre, d’autant que la profession des absinthiers, mal organisée, ne réussit pas à défendre ses intérêts.
Mais malgré cette victoire contre l’absinthe, on ne peut pas dire que le mouvement antialcoolique soit efficace. La consommation globale ne diminue pas car le mouvement n’attaque jamais frontalement le vin : le lobby viticole est très puissant, et il est admis que boire du vin permet de lutter contre l’alcoolisme, moindre mal par rapport aux autres boissons alcoolisées considérées comme plus néfastes. Il faut alors attendre les années 1950 pour assister à un renouveau de la lutte quand le mouvement antialcoolique devient étatique, sous l’impulsion de Pierre Mendès France et du professeur Debré, dont les deux mesures emblématiques sont le verre de lait chaque matin et l’interdiction du vin dans les cantines scolaires. De nouveaux organismes de lutte et de prévention voient alors le jour, avec un discours et surtout des actions plus ciblées dans les décennies qui suivent (jeunes, femmes enceintes, alcoolisme routier, etc.).
Enfin, selon vous, comment le vin est-il devenu, au cours de l’époque contemporaine, un symbole si ancré de l’alimentation française ?
D’une part, la dimension économique du vin explique cet ancrage : le vin est en France un gigantesque marché, qui fait vivre une dizaine de millions de personnes au début du XXe siècle, et est aujourd’hui l’un des produits les plus exportés. D’autre part, la dimension culturelle du boire est très prégnante depuis le XVIIIe siècle. Roland Barthes, par exemple, a bien décrit cet aspect quasi sacré du vin ; et surtout, les notions de plaisir et de convivialité sont au moins aussi importantes dans la consommation du vin, et plus globalement d’alcool, ce qui explique d’ailleurs que l’antialcoolisme peine encore à se faire entendre en France et que régulièrement, la loi Évin (qui vise à limiter la publicité pour la consommation de boissons alcoolisées) soit attaquée, modifiée ou contournée.
–
L’ouvrage de Stéphane Le Bras, Le Négoce des vins en Languedoc. L’emprise du marché, 1900-1970 est publié aux Presses universitaires François Rabelais.