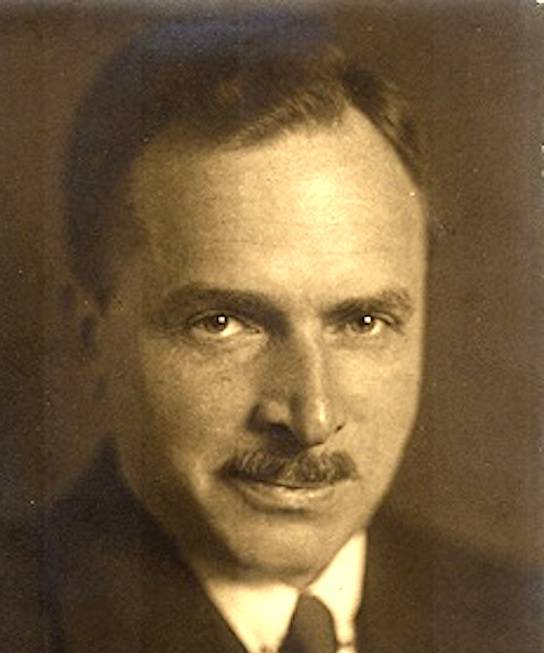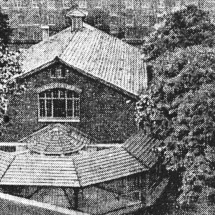Le planisme a eu aussi une influence sur le groupe X-Crise (pour Polytechnique-Crise), c’est-à-dire le Centre polytechnicien d’études économiques, dont plusieurs membres se positionnaient à l’aile gauche et révolutionnaire de la SFIO – on les nommera aussi les « pivertistes », du nom de son principal théoricien, Marceau Pivert. Les pivertistes restent à la SFIO jusqu’au Front populaire, où, déçus par la « pause », décident de la quitter et de créer le Parti socialiste ouvrier et paysan en 1938. Lors de l’armistice, Pivert appelle à la résistance. Malgré tout, parmi les pivertistes, certains collaboreront avec l’occupant.
C’est notamment le cas de Georges Soulès, ingénieur des Ponts et Chaussées, membre à la fois des Étudiants socialistes – comme Claude Lévi-Strauss –, du groupe X-Crise et de la « Révolution constructive ». Contrairement au reste des pivertistes, il reste au sein de la SFIO et se rapproche de l’aile pacifiste de Zoretti, dont il devient le secrétaire. Durant la guerre, il est membre du Mouvement social révolutionnaire d’Eugène Deloncle, ancien cagoulard, restant méfiant vis-à-vis du Rassemblement national populaire de Marcel Déat. Malgré tout, il est contraint de se rapprocher de ce dernier, les deux formations politiques ayant dû fusionner sur l’injonction d’Otto Abetz, l’ambassadeur du Reich à Paris. À partir de 1942, Soulès s’éloigne de l’extrême droite et donne des informations à la Résistance. Pourchassé à la fois par la Gestapo, la Milice et la Résistance, Soulès fuit en Suisse. Il reviendra en France en 1951. Entre-temps, il s’est transformé en Raymond Abellio écrivain kabbaliste appliquant une méthode numérologique à la Bible et vivant d’une société d’ingénieur-conseil.
Ces différentes trajectoires personnelles, prises dans leur chronologie, proposent une lecture différente de celle de Zeev Sternhell. L’évolution vers la Collaboration n’est pas liée au planisme et/ou au néo-socialisme, mais à une position, ou non, « munichoise » : le pacifisme est en effet un élément important pour comprendre l’engagement dans la Collaboration ou dans la Résistance. Le clivage doit surtout être recherché du côté de la scission entre les munichois et les antimunichois, qui fut plus significative dans l’entrée dans la Collaboration.
En outre, des références au planisme et au néo-socialisme peuvent être discernées dans les futures politiques dirigistes des Quatrième et Cinquième République, marquées par le programme du Conseil National de la Résistance. Elles sont également visibles chez ceux qui ont été appelés les « gaullistes de gauche », notamment Louis Vallon, et chez certains démocrates-chrétiens. À gauche, les thèses planistes et néo-socialistes influenceront l’aile gauche du Parti radical-socialiste, incarné par Pierre Mendès-France et Pierre Cot. Il se retrouvera dans les années 1960 dans certains cercles socialistes.
Au-delà de la polémique, le planisme et le néo-socialisme représentaient une volonté d’encadrer la société des dérives du marché, incarnées par la Grande Dépression, à la suite du krach boursier d’octobre 1929. Surtout, le planisme de cette époque transcendait les idéologies : il était, de fait, mobilisé aussi bien par les démocraties – le New Deal de Roosevelt – que par l’Allemagne nazie d’Hitler.
–
Stéphane François est historien des idées et politologue. Spécialiste des fondations théoriques de l’extrême droite européenne, il est notamment l’auteur des Mystères du nazisme : aux sources d'un fantasme contemporain, paru aux PUF en 2015.