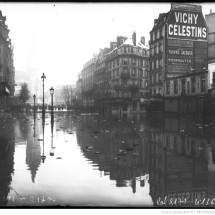Le château du Haut-Koenigsbourg : une reconstruction très politique
Ou comment les ruines d’un château médiéval alsacien sont devenues l’enjeu de débats passionnés entre la France et l’Allemagne avant de devenir une attraction touristique majeure.
Notre histoire commence avec une ruine restée longtemps inaperçue. Au XIXe siècle le château du Haut-Koenigsbourg (département du Bas-Rhin) est en effet l’un des nombreux châteaux médiévaux laissés à l’abandon partout en Europe, dans lesquels affectionnent de se promener les badauds et les auteurs romantiques. On aime s’y perdre pour s’éloigner des villes et retrouver une « nature sauvage », comme Hugo qui en évoque plusieurs dans Le Rhin. Lettres à un ami (1842).
Les donjons en ruines sont même tellement à la mode qu’on leur consacre nombre de gravures depuis le XVIIIe siècle. Le Haut-Koenigsbourg ne fait pas exception et Gallica regorge notamment d’œuvres d’auteurs fascinés par ses tours et ses remparts délabrés, comme cette lithographie réalisée en 1850.
Mais tout change après l’annexion de l’Alsace-Moselle par l’empire allemand en 1871. À la fin du XIXe siècle, le Kaiser Guillaume II décide de marquer symboliquement son contrôle du territoire en lançant une campagne de restauration du château.
Ce choix n’a rien de surprenant. Tout d’abord, la dynastie prussienne avait déjà, au début du XIXe siècle, reconstruit la forteresse médiévale de Marienbourg (aujourd’hui Malbork en Pologne). Il s’agissait alors d’inscrire la famille régnante dans une longue histoire nationale qui se constituait à ce moment et qui faisait remonter la nation allemande au Moyen Âge. Cette dimension est également présente au Haut-Koenigsbourg, mais avec un aspect supplémentaire. Le château alsacien est situé à une vingtaine de kilomètres de la frontière avec la France et le souverain souhaite faire de cette structure une preuve du caractère foncièrement germanique de l’Alsace-Moselle. C’est aussi un symbole largement associé à une imagerie guerrière médiévale.
L’empereur se veut être un nouveau chevalier prêt pour de prochains conflits avec ses adversaires.
Évidemment, un tel programme – même sous-entendu – ne peut que déclencher l’ire de la presse conservatrice et nationaliste hexagonale, d’autant que le Kaiser ne manque pas d’aller sur le chantier de la reconstruction lorsqu’il se rend en Alsace, comme c’est le cas par exemple au mois de mai 1901.
Aussi de l’autre côté des Vosges, craint-on vite le pire. Un article paru dans La Presse oppose ainsi le sanctuaire catholique religieux – donc à leurs yeux, pacifique – de Sainte-Odile au château « protestant » du Haut-Koenigsbourg :
« Certains, cependant, déplorent ces travaux qui, achevés, feront du Kœnigsbourg une concurrence allemande à la colline française de Sainte-Odile. […]
On se demande si le château impérial, avec sa chapelle protestante, n’est pas dressé en manière de défi en face du couvent chrétien où sainte Odile pleura toutes les larmes de son corps… […]
Le Haut-Kœnigsbourg, c’est évident, n’a pas le charme de la colline sacrée de l’Alsace ; les souvenirs qui se rattachent à la vieille forteresse n’ont rien de poétique, comme la légende de la patronne de l’Alsace […].
Et la simplicité des sœurs de la Croix, avec leur cornette blanche et leur robe noire, attirera mieux que les gardiens galonnés qui veilleront sur le château de l’empereur allemand. »
Fernand Hauser, l’auteur de cet article, emploie ici une imagerie du Moyen Âge qui va devenir un lieu commun. D’un côté, il associe la France aux temps médiévaux flamboyants et lumineux des cathédrales gothiques et des édifices religieux – d’ailleurs Sainte-Odile symbolise rapidement l’Alsace française catholique, par exemple sous la plume du nationaliste Maurice Barrès. De l’autre, Hauser lie la monarchie prussienne à une époque féodale guerrière et violente. Deux visions du Moyen Âge donc, pour distinguer deux nations que selon lui tout oppose : la belle et pacifique France et l’Allemagne militariste.
Douze ans plus tard, durant le premier conflit mondial, les propagandistes se resserviront de cet antagonisme lorsque les troupes allemandes bombarderont la cathédrale de Reims.
Mais revenons en Alsace où en 1905, Guillaume II visite une nouvelle fois le chantier du château, ce qui bien sûr déclenche une seconde vague de commentaires sarcastiques de la part de la presse conservatrice française. Pour La Patrie, il s’agit d’un « château ruineux ». Mais c’est une ruine qui est aussi le fruit des caprices personnels d’un autocrate, comme veut le souligner le Journal des débats politiques et littéraires du 26 janvier 1905 :
« L’empereur n’est pas disposé à consentir des sacrifices pour “son castel”. […]
C’est pourquoi il fut décidé de créer une “Société du Haut-Koenigsbourg” qui recueillera des fonds dans tout le pays. Voici quelques mois déjà que l’on travaille certaines personnalités alsaciennes qui, par leur situation, pourraient servir de tremplins à la société et qui ne sont pas assez indépendantes pour refuser leur adhésion. »
Là encore, l’imagerie médiévaliste joue à plein, et l’association entre un château et Guillaume II permet de comparer ce dernier à un hobereau médiéval opprimant son peuple pour un chantier prétendument sans intérêt, une « bâtisse féodale et sans intérêt historique ».
Mais les travaux avancent toujours et en mai 1908, c’est l’inauguration. Celle-ci donne lieu à d’importantes festivités en Alsace, que suit la presse française. Le Figaro envoie même le grand reporter Georges Bourdon sur place pour écrire un compte-rendu de la cérémonie. Durant celle-ci, le Kaiser prononce un discours sans fard qui ne fait pas mystère du sens politique qu’il donne à la reconstruction du château :
« Puisse la Hohkœnigsbourg être conservée jusqu’à l’époque la plus éloignée, ici, dans l’ouest de l’Empire, comme la Marienbourg dans l’est, pour y être le symbole de la civilisation et de la puissance allemandes.
Puisse l’aigle planant sur ce fier château fort étendre toujours ses ailes sur un pays pacifique et un peuple heureux !
C’est en faisant ce fier souhait de prospérité que je prends solennellement possession du château reconstitué et que j’invite le commandant à en ouvrir la porte. »
Un tel programme nationaliste pousse évidemment la presse française de droite à juger durement la tentative de reconstitution menée par l’architecte allemand Bodo Ebhardt. Le Gaulois laisse ainsi la parole à Frantz Funck-Brentano, un archiviste spécialiste du Moyen Âge et proche des cercles royalistes et antisémites. Et celui-ci ne mâche pas ses mots. Il regrette tout d’abord que les ruines n’aient pas été conservées en l’état afin de permettre des promenades romantiques encore possibles à Sainte-Odile et ses alentours.
« Le Haut-Kœnigsbourg était un pittoresque lieu d’excursion pour toute l’Alsace, comme aujourd’hui encore Sainte-Odile. On y venait simplement, gaiement, sans attacher à ces vieilles pierres d’autre sens que celui de la beauté qui s’en dégageait, beauté romantique où se mêlaient des rêves et des légendes. »
Au contraire, désormais au Haut-Koenigsbourg, ce serait le règne de l’artificiel, du faux, du moderne en somme, et mis au service du nationalisme allemand.
« Les ruines du Haut-Kœnigsbourg, l’empereur vient donc de les faire retaper. Voici du XIe siècle flambant neuf et Guillaume II inaugure cette restauration en une de ces cérémonies archéologiques et théâtrales où se complaît son goût wagnérien. […]
L’empereur d’Allemagne, au milieu des hauts dignitaires de l’Empire […] discourt dans un décor d’opéra-comique, et qui n’a même, de l’opéra-comique, le charme, la grâce et l’originalité. […]
Dure et rude leçon, où devait aboutir cette folie destructrice qui se nomme en Allemagne la manie de l’Altdeutsch, du “vieil-allemand”. Combien de ruines pittoresques sur les bords du Rhin […] ont ainsi perdu leur sauvage et romantique beauté. »
Sur un ton beaucoup plus policé, Georges Bourdon va même plus loin. Jamais dans son article il n’emploie pour désigner le château le toponyme français de Haut-Koenigsbourg, mais utilise plutôt celui allemand de « Hohkœnigsbourg ». Manière de dire que la reconstruction a dépouillé le lieu de tout caractère hexagonal et en a fait un endroit germanique – c’est-à-dire, pour lui, détestable.
Même chose dans L’Autorité, un autre journal conservateur, pour qui « Guillaume II, en inaugurant le Château de Haut-Kœnigsbourg, affirme la conquête définitive de nos deux provinces ».
La guerre passe. Changement de décor. Dans une Alsace de nouveau française, il est urgent d’organiser des cérémonies pour marquer le rattachement à l’Hexagone de la région. Le Haut-Kœnigsbourg et sa reconstruction associée à l’empire allemand sont particulièrement visés.
Dès janvier 1919, le maréchal Pétain, auréolé de sa victoire à Verdun, prend possession du château, comme le rapport en page de Une Le Petit Journal quelques mois plus tard. L’article insiste aussi sur le fait que la forteresse rebâtie était liée à la personne de Guillaume II. Il y est venu, mais désormais chassé, ne reviendra plus. Le châtelain impérial, associé à un tyran féodal, a été délogé de son donjon par une république moderne. Et la structure symbole de cette tyrannie, continue le texte, pourrait donc légitimement être dynamitée.
« Ah mon beau château.
Le Kaiser avait un château en Alsace.
Ce château de faux Moyen Âge est […] plein de symboles contemporains. Il est aujourd’hui confié à la garde du lieutenant Walter, un enfant de Schlestadt qui servit vingt ans dans l’armée française […]. Il est gouverneur du Haut-Kœnigsbourg pour la République française.
Qu’est-ce que la République française va faire de ce château, qui va être remis sans doute à l’administration des Beaux-Arts ? La première idée qui vient à l’esprit, c’est de restaurer la ruine, qui était noble et grande, en faisant sauter l’œuvre de l’architecte boche. Ou plutôt ne conserverons-nous pas ce monument si exact du mauvais goût et de l’orgueil germaniques, comme le souvenir du temps de prison de l’Alsace ? »
Finalement, en septembre 1919, un mois après la visite du président de la République Raymond Poincaré au château, il est décidé de le conserver et de transformer ce « vieux castel, si maladroitement restauré » selon les termes du Petit Journal, en « musée du patriotisme alsacien ». À nouveau, le château devient un outil politique, non plus pour prouver la germanité de l’Alsace, mais au contraire sa francité.
Ces emplois nationalistes trouvent leur réponse en 1937 quand Jean Renoir fait du château le décor de son film La Grande Illusion. Ce long-métrage dépeint les épreuves de prisonniers de guerre alliés pendant la Première Guerre mondiale dans les geôles allemandes. À force d’évasions, ceux-ci finissent derrière les barreaux de la forteresse féodale.
Celle-ci dans le propos du film, a alors deux fonctions symboliques. Réussir à s’enfuir loin de ses donjons crénelés, c’est s’échapper de la vieille Europe des empires qui s’entre-déchirent pour espérer parvenir à un nouveau monde de paix et de fraternité, propos qui se retrouve bien sur l’affiche du long-métrage réalisé par les Affiches Crépa en 1938. On y aperçoit en effet au fond deux officiers qui semblent prisonniers de la grisaille du donjon alors qu’au premier plan, un homme et une femme, un Français (joué par Jean Gabin) et une Allemande (incarne par l’actrice Dita Parlo) s’embrassent au milieu d’un paysage champêtre.
Mais le château, c’est aussi une métaphore de cette Europe où selon Renoir, les nations seront bien un jour obligées de coexister pacifiquement. Même prisonniers de ses murs, les deux officiers, à nouveau un Français et un Allemand (joués respectivement par Pierre Fresnay et Erich von Stroheim) se lient d’amitié malgré l’horreur de la guerre. Ils ne s’affrontent plus pour posséder la forteresse, comme un Pétain chassant le Kaiser, mais tentent d’y cohabiter.
Tout cela est pleinement assumé par Jean Renoir, qui fait de son film un manifeste contre le racisme et l’antisémitisme qui secouent, en cette fin des années 1930, nombre de sociétés européennes :
« J’aurai dans mon film […] des gens de toutes les nationalités et de toutes les classes : le professeur Itkine, l’ingénieur belge Gaston Modot, le serrurier Georges Péclet, le comédien Carette…
Il y aura aussi le juif Rosenthal-Dalio, qui joue souvent le rôle d’interprète ; et il sera aussi – n’en déplaise à certains – brave, généreux et héroïque. »
Cette dimension de fraternité aussi pleinement perçue par des journalistes. Dans Paris-soir le 12 février 1937, Jany Casanova s’amuse à écrire cette phrase en tête de l’article qu’elle consacre au film de Renoir :
« Au sommet du Haut-Kœnisbourg, un général français est salué par des soldats allemands… mais c’étaient des figurants de La Grande Illusion. »
Comme si le château, jadis théâtre de discours martiaux, se muait en théâtre d’une illusion, celle d’une paix possible entre les deux nations bordant le Rhin.
Il faudrait attendre l’après-guerre et la construction européenne pour que le rêve de Renoir voie le jour. Désormais, le château du Haut-Koenigsbourg a perdu ses dimensions nationalistes pour redevenir un lieu de visites et de promenades.
–
Pour en savoir plus :
William Blanc, « Donjons & Moutons. Une réflexion sur les objets médiévalistes », in : Martin Aurell, Florian Besson, Justine Breton et Lucie Malbos (dirs.), Les médiévistes face aux médiévalismes, Rennes, Presses universitaires de Rennes, p. 25-36
Myriam Roman, « Châteaux en Allemagne : les burgs en ruine dans Le Rhin (1842) de Victor Hugo », in : Auraix-Jonchière Pascale, et Gérard Peylet, (dirs.), Châteaux romantiques. Presses Universitaires de Bordeaux, 2005, p. 347-363
Jean-Claude Richez, « Le Château du Haut-Koenigsbourg. Frontière, mémoire, illusion », in : L’identité : un mythe refuge ? Revue des sciences sociales de la France de l’Est, N° 18, 1990, p. 125-129
Jean-Claude Richez, Alain Willaume, Haut-Kœnigsbourg. Le château d’illusion, Strasbourg, La Nuée bleue, 1990
Bernadette Schnitzler, Jean Favière, 13 mai 1908. Une inauguration mouvementée. Les Cahiers du Haut-Koenigsbourg, vol. 1, Saverne : Association Alsace médiévale, 2018