Les Français et la guerre de 1870 : stupeur, amertume et résilience

Comment les Français ont-ils traversé la Guerre de 1870 ? L'historien Jean-François Lecaillon a exhumé des milliers de témoignages écrits qui la racontent telle que l'ont vécue jeunes conscrits, militaires de carrière et simples citoyens.
La guerre franco-allemande de 1870 a profondément marqué le XIXe siècle et a considérablement influé sur le XXe. Comment les Français ont-ils vécu ce conflit, dont rien ne laissait présager l'extrême violence et les répercussions politiques ? Quelles traces a-t-il laissées dans l'histoire contemporaine ? En exhumant lettres, journaux intimes, carnets de guerre et récits de souvenirs, l'historien Jean-François Lecaillon a mené une enquête passionnante, qui met en lumière l'intensité des sentiments des combattants et des civils pendant et après le conflit de 1870.
Propos recueillis par Marina Bellot
-
RetroNews : Vous rappelez que le conflit part d’une simple question de succession au trône d’Espagne. Quelles en sont, selon vous, les raisons plus profondes ?
Jean-François Lecaillon : La question de la succession au trône d’Espagne est le déclencheur, mais c’est en réalité un prétexte qu’utilise Bismarck qui veut provoquer le conflit à des fins d’unification de l’Allemagne. Dans cette perspective, il a besoin d’un adversaire commun pour fédérer les peuples germaniques.
Côté français, on est dans la défense d’une primauté européenne et le prolongement de la politique de Napoléon III visant à renforcer les frontières de l’Est et à annexer de nouveaux territoires, comme il a pu le faire au terme de la campagne d’Italie (gain de Nice et de la Savoie). Dans le préambule du conflit de 1870, il envisageait au mieux une annexion, sinon une neutralisation du Luxembourg. Mais la raison principale vient bien de l’Allemagne et de Bismarck.
Au déclenchement du conflit, George Sand écrit : « Je comprends le chauvinisme quand il s'agit de délivrer un peuple comme la Pologne ou l'Italie ; mais entre la France et la Prusse, il n'y a en ce moment, qu'une question d'amour-propre, à savoir qui aura le meilleur fusil ». Partagez-vous cette analyse ?
Ce qu'elle exprime me parait judicieux et pas du tout anecdotique car c’est l'expression de ce qui a été utilisé par tous les acteurs politiques : le sentiment national. En Allemagne, il s’agit de construire la grande Patrie aux dépens des petites ; en France, on est plutôt dans l’effort de consolidation du sentiment né en 1792.
Comment l’annonce du conflit est-elle accueillie par les Français ?
Le plébiscite du mois de mai, largement remporté par Napoléon III, est présenté comme un vote en faveur de la paix. L'Empire est la garantie de la force et de la puissance. Quand la guerre éclate, si l’on regarde de près les témoignages écrits des jeunes conscrits, des militaires de carrière ou du simple citoyen, on voit plusieurs sentiments s’enchaîner.
Il y a d’abord la stupeur : le déclenchement de la guerre est une surprise ; puis la colère, notamment de la part de ceux qui voyaient le plébiscite comme une garantie de paix et de prospérité. Ils se sentent trahis. Se greffe là-dessus la crainte, celle qui vient traditionnellement des milieux ruraux, de celui des affaires dont la guerre menace les intérêts commerciaux et de certains militaires, en particulier ceux qui sont dans l’artillerie. Ils ont conscience de la puissance de feu des canons allemands et en redoutent l’efficacité.
La fièvre gagne les Français une fois la mobilisation décrétée. Comment expliquer un tel enthousiasme ?
Effectivement, aux alentours du 20 juillet, se multiplient les scènes de liesse. Plusieurs éléments se combinent pour les expliquer : d’abord, le discours officiel qui met en avant l’idée d’une guerre qui va être facile, courte et victorieuse. Cette promesse crée un sentiment de confiance susceptible de générer des manifestations de gaité.
Il y a ensuite un phénomène de contamination assez commun : les jeunes recrues se retrouvent dans des groupes qui partent avec le fusil et l’uniforme, réalité qui leur donne un sentiment de force. Certains aussi fanfaronnent pour cacher leur peur… Confrontée à ce spectacle, la foule applaudit un défilé qui passe, des hommes fringants qui vont à la victoire…
À cela s'ajoute la peur de passer pour un traître ou un défaitiste, dans un moment où commence à poindre l’espionnite. Mais il y a un grand décalage entre les sentiments exprimés en public et ceux qui le sont en privé : dans le cadre de l’intimité, l’inquiétude prévaut.
Dès leurs prises de fonction, nombre de responsables militaires constatent manques et dysfonctionnements. Quels sont-ils ?
La débâcle s'explique en effet par une addition d'impréparations et de dysfonctionnements : les conscrits sont mal préparés, l'intendance ne suit pas bien, les chemins de fer sont mal utilisés, etc. À ces défauts s'ajoute l’absence de stratégie d’ensemble. Les Allemands ont, au contraire, préparé leur affaire.
À ce déséquilibre technique entre les deux camps s'ajoutent des différences dans l’autonomie laissées ou non par le Haut-commandement aux officiers intermédiaires. Côté français, la hiérarchie est rigide, alors que côté allemand, l’initiative est laissée aux chefs de corps. Celle-ci, à plusieurs reprises, a failli leur être fatale. Rien n’était joué d’avance.
Ajoutez à cela la présence de Napoléon III qui est avec l’armée. Il est malade et représente une charge à la fois physique et mentale pour le commandant en chef. Les rivalités entre les généraux ont aussi des effets désastreux : ils tardent, par exemple, à appeler des renforts quand ils sont mis en difficulté car ils croient pouvoir s'en tirer seuls. C’est le cas de Frossard à Forbach, par exemple.
Enfin, il y a un mélange de soldats de carrière, performants mais qui ont fait leurs armes dans des guerres de type coloniale au Mexique ou en Algérie, et d’appelés qui manquent d’instruction militaire. Des témoignages relatent ainsi des situations dans lesquelles les bons soldats sont obligés de se replier parce qu’ils sont mis en danger par les moins expérimentés. C’est donc une accumulation d'erreurs et de contre-performances qui entraîne la débâcle.
La capitulation de Sedan scelle toutefois le sort des Français. Si Bismarck n'avait pas mis l'Alsace-Lorraine dans la balance des négociations de paix en septembre, la guerre s'arrêtait là. En revendiquant l’annexion de ces deux provinces, il a provoqué l'inacceptable - Jules Favre ayant dit qu’il ne céderait pas un pouce de terrain - et une deuxième guerre a alors commencé.
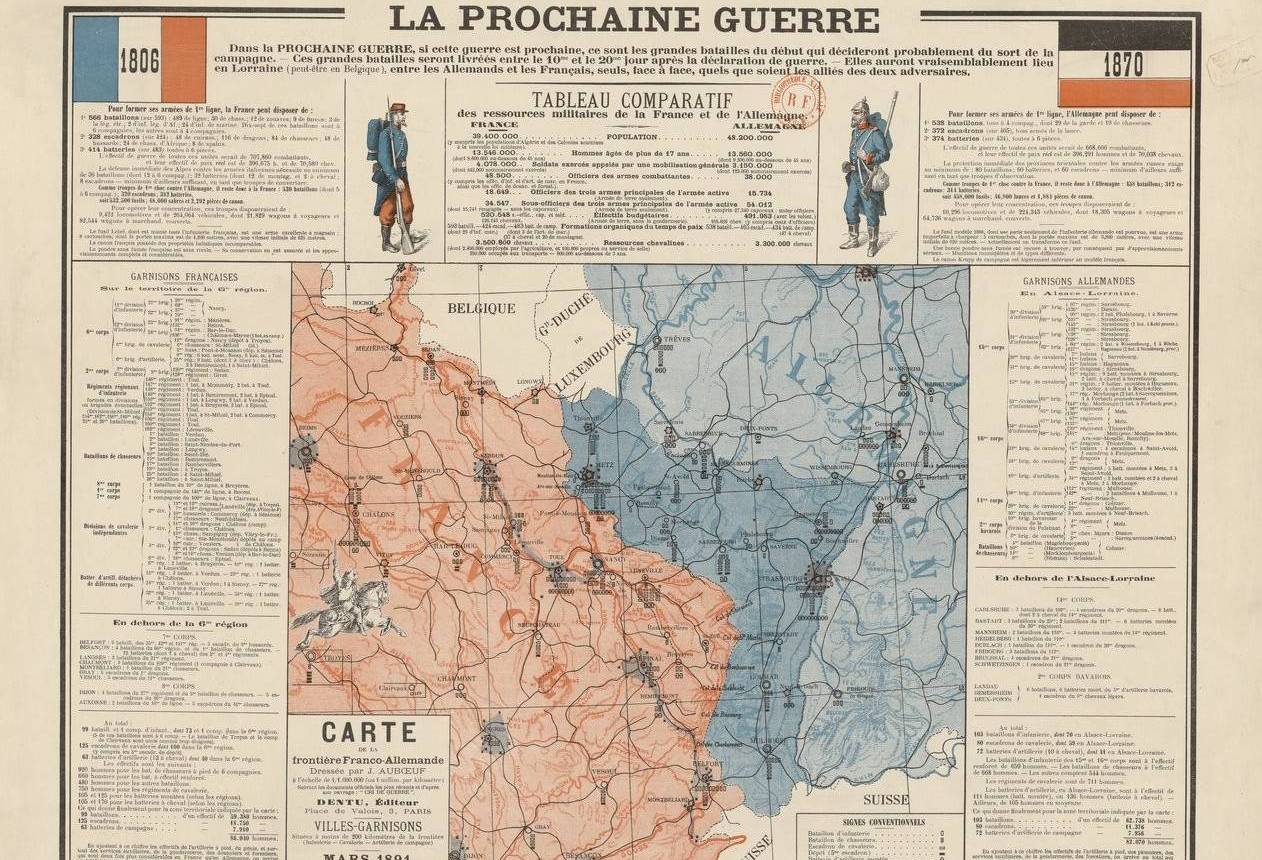
Vous montrez dans votre livre que le conflit génère une succession de débâcles et d’espoirs, d’illusions puis de désillusions…
Oui, l’opinion bascule constamment. Pendant le siège de Paris, par exemple, on a d’abord la stupeur de la mauvaise nouvelle, l'abattement, la résignation puis tout à coup un événement surgit qui provoque une colère, et un retour à une forme d’enthousiasme un peu forcé, à l’expression surtout d’une volonté de ne pas céder à l’inacceptable. Alors commence un nouveau cycle jusqu'à l’échec suivant…
Quels sont les grands moments du conflit selon vous du point de vue de l’opinion ?
J’en relèverai au moins quatre. D’abord les combats sur les frontières de l’Est, les premières défaites du début août, qui provoquent la stupeur, puis une volonté de réagir. Certains combattants parlent alors de prendre leur revanche. Le mot n’a pas encore le sens qu’il prendra plus tard.
Vient ensuite la capitulation de Sedan : c’est le drame. La République est proclamée et naît soudain l'illusion d’une nouvelle guerre qui peut être gagnée parce qu’elle sera celle des Français et non plus de l'Empereur. Le fantasme de voir se reproduire le sursaut de 1792 redonne espoir. Dans les correspondances de l’époque, le processus est frappant. Les Français s’imaginent qu’ils vont gagner car le peuple entier va se soulever...
La troisième séquence est liée à la capitulation de Metz. Se mêlent alors colère, sentiment d’être trahis et résignation. Puis le mouvement repart pour une nouvelle campagne, qui peut connaître le succès parce qu’elle sera menée sans les traîtres. Le doute domine, mais l’espoir renaît un peu.
Le quatrième mouvement important est, pour moi, la bataille de Buzenval du 19 janvier 1871. Ceux qui vont y participer ont la certitude que cette nouvelle tentative est vouée à l’échec. Ils y vont aussi avec l’idée que Trochu est en train de les sacrifier pour justifier une capitulation déjà décidée. Mais il faut tenter le tout pour le tout, ne serait-ce que pour l’honneur. Dans ses dernières lettres, le peintre Henri Régnault, qui est tué ce jour-là, exprime très bien ce sentiment. L’abattement qui suit l’échec et la colère d’avoir été une fois encore trahis, qui s’exprime lors de la manifestation du 22 janvier annonce le soulèvement du 18 mars, puis la Commune. C’est en cela que ce moment me paraît important.
Tous ces va-et-vient émotionnels sont révélateurs de la manière dont fonctionne une opinion publique. On retrouve ces oscillations sur d’autres questions à d’autres époques.
À la fin du conflit, George Sand écrit à Gustave Flaubert : « Nous avons tous souffert par l'esprit plus qu'en aucun autre temps de notre vie, et nous souffrirons toujours de cette blessure ». Que reste-t-il du conflit dans le cœur des Français au lendemain de la défaite ?
Il y a bien sûr une forme de déception, d’amertume et l’idée d’une revanche à prendre. Mais quand on regarde dans le détail, l’affaire est plus compliquée. L'abattement a duré peu de temps, celui nécessaire pour que les Français fassent le deuil des disparus, que ce soit au niveau collectif ou privé.
Tout bascule aux alentours de 1873 et autour de deux œuvres emblématiques : le tableau d’Alphonse de Neuville, Les Dernières cartouches, et la sculpture d’Antonin Mercié, Gloria Victis. Tout est dans le titre de cette dernière qui dit, en substance : Nous avons été vaincus, mais nous sommes les vrais vainqueurs. C’est le moment où le processus de résilience se met en place. Les Français se disent que la défaite subie est un accident et qu’ils n’ont pas pu montrer leur véritable valeur. Sûrs de leurs qualités, ils veulent se mobiliser pour prendre leur revanche. Mais, dans cette perspective, plusieurs perceptions différentes de la situation se combinent, se superposent, voire se concurrencent.
Pour les vétérans, la défaite est une affaire personnelle, une faute qui leur revient et qu’ils veulent réparer par eux-mêmes. Ils veulent leur revanche sur le terrain militaire, dans les deux ou trois ans, le temps de réorganiser l’armée. Ce désir déçu s’apaise au fil du temps pour se transformer en demande de reconnaissance de la Patrie qu’ils obtiennent tardivement, en 1911.
Il y a ensuite la vision des Opportunistes, les proches de Gambetta. Conscients qu’une guerre de revanche contre l’Allemagne renforcée par ses alliances (la Triplice) est impossible, ils imaginent la revanche sur un autre terrain. Contre les Allemands et Bismarck présentés comme des « barbares » pour qui la force prime sur le droit, ils se posent en champions du droit qui prime sur la force. Dans cette approche, les ministres de l'Instruction publique et des Arts s'adressent aux artistes à l’occasion du Salon de Vienne (1873) puis de l'Exposition universelle de 1878. Dans les discours qu’ils leur tiennent, ils les comparent à des soldats comme les autres, mais qui se battent avec le pinceau. Ils les invitent ainsi à montrer au monde que dans le domaine des Arts les Français sont les meilleurs. L’esprit est le même dans l’éducation (on va former nos jeunes pour qu’ils redressent le pays, mais avec des valeurs positives : l’amour de la patrie et de la paix), dans le cadre de la colonisation (qui se veut civilisatrice), des sciences et des techniques (avoir les meilleurs savants et ingénieurs).
Pour une majorité de Français, cette forme de revanche est acquise en 1878. C’est l’année de l’Exposition universelle à Paris, couplée avec l’anniversaire de la Révolution de 1848, et ceux de la mort de Rousseau et de Voltaire. « 1878, Année mémorable », proclame Victor Hugo, « glorieuse année » dont « l’œuvre sera indestructible et complète » assure-t-il dans son discours d’ouverture du Congrès littéraire international, lequel se tient lui aussi à Paris. De quoi faut-il se souvenir, selon lui ? Que la France a les meilleurs philosophes, savants, artistes, écrivains…parce qu’elle est la Lumière du monde...
« Sept ans après les plus cruelles atteintes qu’un peuple ait eu à souffrir », peut-on lire dans le Temps du 2 mai 1878, « nous nous sommes trouvés en mesure de donner à l’Europe le pacifique et solennel rendez-vous de l’Exposition, cette constatation de l’effacement de nos maux, de la reprise du rôle civilisateur de la France, [qui] a causé une satisfaction générale. » On ne peut être plus clair.
Ce sentiment de revanche symbolique se retrouve lors de l’Exposition universelle de 1889. Quand Gustave Eiffel présente son projet, il donne des arguments techniques, vantant la supériorité des ingénieurs français sur leurs rivaux allemands et américains. Un de ses arguments s’appuie aussi sur la mémoire de 1870 : s’il y a une nouvelle guerre, Paris disposera d’une tour de laquelle on pourra voir venir l’ennemi. Le souvenir de 1870 apparaît là, et l’un de ceux qui le reprend pour dire tout le bien qu’il pense du monument alors controversé, est Gaston Tissandier, aéronaute qui quitta Paris assiégée en ballon. Vingt ans après, la tour Eiffel, est ainsi justifiée comme un moyen de prendre une revanche symbolique sur l’Allemagne.
Dans ce contexte, le revanchisme militaire existe, bien sûr, mais il n’a jamais réussi à l'emporter sur le terrain politique. Et en 1914, les Français ne répondent pas à l’appel de la Patrie pour faire revanche de 1870. Politiquement parlant, une telle raison ne pouvait pas être énoncée devant les Alliés, qui n’auraient pas accepté d’entrer dans une guerre pour régler un vieux différend franco-allemand. C’est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et celui à la légitime défense de la Belgique qui sont alors mis en avant. Ces arguments fonctionnent bien auprès de l’opinion publique. D’autant mieux que ceux qui sont envoyés sur le front n’ont pas connu la Guerre de 1870. Élevés dans le culte de la Patrie, ils ne l’ont pas été dans l’esprit de la Revanche, auquel n’adhéraient pas les instituteurs patriotes certes, mais plutôt pacifistes.
Bien sûr, la revanche fut validée par le Traité de Versailles. Mais n’est-ce pas là expression d’une opinion a posteriori ?
-
Jean-François Lecaillon est historien, spécialiste des guerres du Second Empire. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur la guerre de 1870, dont Les Français et la guerre de 1870, paru en 2004 et réédité en 2020 aux éditions de l'Artilleur.












