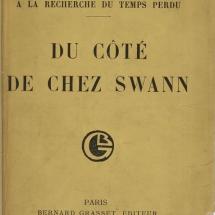Lorsque faire grève était interdit : entretien avec Stéphane Sirot
Sous la Révolution et l'Empire, la grève est interdite et pénalement sanctionnée. Tout va changer en 1864 avec la loi Ollivier qui permet, pour la première fois, aux salariés d'arrêter de travailler sans risquer d'être poursuivis. Quels mécanismes ont permis cette évolution législative ?
Historien français, spécialiste du syndicalisme et de la sociologie des grèves, Stéphane Sirot enseigne l'histoire politique et sociale du XXe siècle à l'université de Cergy-Pontoise, ainsi que l'histoire et la sociologie du syndicalisme à l'université de Nantes.
On lui doit notamment La grève en France, paru aux Éditions Odile Jacob en 2002, Le syndicalisme, la politique et la grève aux éditions de l'Arbre bleu en 2011, et 1884 : des syndicats pour la République édité par Le Bord de l'eau en 2014.
Propos recueillis par Arnaud Pagès
–
RetroNews : Dans quel contexte la loi Ollivier est-elle votée ?
Stéphane Sirot : Pour comprendre l'évolution de la législation, il faut revenir à la Révolution française et à la loi Le Chapelier de 1791, qui interdit strictement la grève. En 1810, le Code pénal va même aller encore plus loin en durcissant les sanctions à l'encontre des grévistes. Jusqu'au Second Empire, il va y avoir des épisodes de répression, mais aussi des conflits qui durent dans le temps et qui peuvent déboucher à l'occasion sur l'acceptation de certaines revendications par le patron.
En 1864, la loi Ollivier va dépénaliser la grève, mais sans la légaliser pour autant. Alors que le Second Empire décline, l'élite politique souhaite s'attirer les bonnes grâces du monde ouvrier qui était, jusque-là, très largement marginalisé et étroitement surveillé. C'est un corps social que l'on craint beaucoup dans les cercles du pouvoir.
Par ailleurs, à partir du milieu du XIXe siècle, la question de la pénibilité du travail en usine commence à émerger. L'industrialisation bat son plein et le patronat a besoin d'une main-d'œuvre productive et en bonne santé. Il faut donc envisager de lâcher la bride.
Enfin, il ne faut pas oublier que les grèves existent bien qu'elles soient interdites, avec une montée en puissance progressive de cette pratique dans le monde ouvrier. Elles deviennent un fait de société. L'ordre dominant est obligé d'en tenir compte. De ce fait, il semble plus avantageux d'avoir des mouvements sociaux qui se déroulent au grand jour, plutôt que dans la clandestinité. Avant 1864, les ouvriers se réunissaient en dehors de la ville, et généralement la nuit. Ils s'organisaient à l'intérieur des sociétés de secours mutuelles qui étaient autorisées, pour former des unités de résistance qui n'avaient pas d'existence légale. Tout ceci était caché aux yeux du pouvoir.
Avant 1864, qu'est-ce que les grévistes risquaient lorsqu’ils décidaient d’arrêter le travail ?
Ils risquaient d'abord la répression du mouvement. La maréchaussée intervenait et procédait à des rappels à la loi. A partir de là, soit les ouvriers reprenaient le travail, soit ils étaient mis en état d'arrestation. Certains partaient s'embaucher ailleurs car aller chercher un meilleur salaire dans une autre entreprise était un moyen pour obtenir ce qu'ils voulaient. A l'époque, il y avait beaucoup de turnover.
L'archétype de la répression, ce sont les grèves de mineurs ou l'armée était envoyée dans les corons pour maintenir l'ordre et protéger les non-grévistes. Il y avait régulièrement des affrontements, et de temps en temps des morts, car les soldats n'étaient pas formés pour ce type de missions et n'hésitaient pas à tirer lorsqu'ils se sentaient menacés. Il y avait des procédures juridiques qui pouvaient déboucher sur des amendes ou des peines de prison prononcées à l'encontre des meneurs. L'arsenal répressif était très conséquent. A la veille de 1864, l'État cherche à construire une posture mêlant conciliation et répression.
Qu'est-ce que la loi Ollivier permettait aux ouvriers de faire ?
Dépénaliser la grève signifiait qu'arrêter le travail n'était plus répréhensible. Les ouvriers ne risquaient plus d'être sanctionnés. En revanche, il ne leur était pas possible de contraindre ceux qui ne voulaient pas y participer. Le délit d'entrave à la liberté du travail fera toujours l'objet de nombreuses condamnations après 1864. C'est un délit qui figurait dans la loi Le Chapelier, et qui est d'ailleurs toujours en vigueur aujourd'hui.
Par ailleurs, rien n'interdisait aux patrons de remplacer les grévistes, ou même de les renvoyer. Rappelons qu'il faudra attendre la Seconde Guerre mondiale pour que la grève devienne un droit constitutionnel. En étant si frileux à accorder ce droit au monde du travail, l'État participait à construire une régulation conflictuelle des rapports sociaux. Le fait d'avoir du mal à accepter la grève, et donc de nier les revendications, génèrera un fort retard de la France, notamment vis-à-vis de l'Angleterre ou de l'Allemagne, à s'engager dans des processus pacifiés.
Le fait qu'il faudra attendre 1884, c'est-à-dire vingt ans, pour que les syndicats soient autorisés n'arrangera rien à l'affaire. Chez les militants, ce long délai va créer de la méfiance envers le pouvoir et la République... Ailleurs, la grève avait été permise en même temps que la possibilité des ouvriers à s'organiser entre eux. Il y a eu un déficit de reconnaissance qui a incité le syndicalisme français à se construire dans des pratiques de clandestinité et d'opposition à l’État.
La loi Ollivier provoque-t-elle un effet d'entraînement, avec davantage de grèves ?
Elle va avoir tendance à « libérer les énergies ». A partir du moment où les ouvriers savaient que faire grève ne produit plus de menaces répressives, la décision d'arrêter le travail devient plus facile à prendre. Entre la fin du XIXe siècle et la Première Guerre mondiale, on assiste à une très forte montée en puissance des grèves, le syndicalisme français considérant par ailleurs que cette pratique est le moyen le plus efficace pour se faire entendre. Le nombre d'ouvriers qui franchissent le pas augmente fortement.
En 1884, la loi Waldeck-Rousseau autorise les syndicats, marquant ainsi une nouvelle étape du droit de grève. Quels effets produit-elle ?
Précisons qu'elle provient des mêmes évolutions. Le fait que les ouvriers s'organisent entre eux est devenu un fait social que le pouvoir en place ne peut pas ignorer. Dans la logique du législateur, il apparaît donc plus efficace de promulguer cette autorisation plutôt que de maintenir le syndicalisme dans la clandestinité. Le but du pouvoir est d'être en mesure de le jauger pour mieux le contrôler. De fait, cette loi va avoir un effet de régulation en fluidifiant les rapports de classe.
L'élite politique visait une autorégulation du champ social qui passerait par des conflits entre ouvriers et patrons encadrés, mieux gérés, et in fine apaisés. Enfin, cela permettait à l'État de se désengager de ces questions. Ces évolutions n'allaient pas de soi et ont fait l'objet de débats particulièrement durs entre parlementaires.
Au-delà de l’aspect légal de la grève, quel bilan pourra-t-on tirer de la loi Ollivier ?
Dans un premier temps, elle aura fortement renforcé le contre-pouvoir du monde ouvrier. Ensuite, elle aura permis de banaliser progressivement la pratique gréviste. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, il fait rappeler que les patrons acceptaient mal de devoir négocier. Dans l'entre-deux-guerres, il devient naturel que les ouvriers posent des revendications et arrêtent de travailler. Au fil du temps, la conflictualité des rapports sociaux deviendra normale.
En France, rappelons que la tradition est d'abord de faire grève pour négocier ensuite, alors que l'inverse est tout à fait envisageable. Le cadre posé par les lois de 1864 et de 1884 finira par satisfaire tout le monde, aussi bien à l'État que les syndicats et le patronat.
–
Stéphane Sirot est historien. Il enseigne l'histoire politique et sociale du XXe siècle à l'université de Cergy-Pontoise, ainsi que l'histoire et la sociologie du syndicalisme à l'université de Nantes.