14-18 : Les journaux en guerre
« 14-18 Les journaux en guerre »
L'actualité de la première guerre mondiale en 10 grandes dates et 10 journaux publiés entre 1914 et 1918. Une collection de journaux réimprimés en intégralité.
Pour accéder à l’ensemble des fonctionnalités de recherche et à tous les contenus éditoriaux, abonnez-vous dès aujourd’hui !
Pour accéder à l’ensemble des fonctionnalités de recherche et à tous les contenus éditoriaux, abonnez-vous dès aujourd’hui !

En 1879 s’ouvre l’« immortel congrès » ouvrier de Marseille, rassemblant tout ce que la France compte alors de groupes socialistes. La presse conservatrice examine non sans acrimonie ces partisans de l’Internationale.
En octobre 1879 se réunit à Marseille le troisième « congrès ouvrier ». Depuis l’échec de la première tentative d’organisation internationale du mouvement ouvrier (l’Association Internationale des Travailleurs, fondée en 1864, a été dissoute de fait en 1873) et l’écrasement de la Commune de Paris en mai 1871, les courants socialistes (qui forment alors un ensemble bigarré et hétérogène) cherchent à constituer une organisation un minimum structurée et pérenne.
C’est l’objectif affiché du troisième congrès ouvrier dont le nom est resté dans l’histoire comme « l’immortel congrès ». L’expression est d’un certain Jules Guesde, qui deviendra peu de temps après un des principaux représentants de cette organisation (il n’est pas à Marseille en octobre pour raisons de santé). « L’immortel congrès » est bien une expression postérieure, que l’on ne retrouve pas dans la presse de l’époque ; mais elle sera largement reprise en suite dans la mémoire militante, puis dans tout récit historique faisant allusion à ces événements. Il s’agit d’une des structures à l’origine du Parti socialiste qui sera unifié ultérieurement, en 1905.
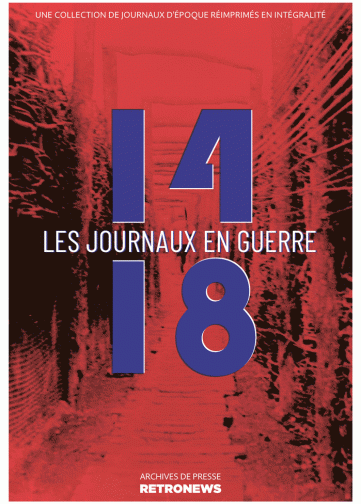
14-18 : Les journaux en guerre
« 14-18 Les journaux en guerre »
L'actualité de la première guerre mondiale en 10 grandes dates et 10 journaux publiés entre 1914 et 1918. Une collection de journaux réimprimés en intégralité.
Guesde s’est fait connaître comme journaliste républicain à Montpellier lors des événements de 1870-1871 ; condamné pour son action militante, il s’est réfugié en Suisse où il se rapproche des anarchistes. De retour en France, il devient progressivement marxiste, idéologie qui commence à pénétrer en France, notamment via des exilés allemands présents à Paris. Guesde commence à faire paraître le journal L’Égalité, au nom évocateur, en 1877, qui devait bientôt devenir le premier journal marxiste français.
Guesde a déjà une réputation d’intransigeant qui ne passe pas inaperçue ; Le Petit caporal, journal bonapartiste, le souligne avec malice le 14 août 1879. Ce qui, d’après ce journal, ne lui vaut pas nécessairement un écho favorable même chez ceux qui pourraient être tentés par le rejoindre :
« On est toujours, a-t-on dit depuis longtemps, le réactionnaire de quelqu’un. Voici MM. Louis Blanc et Clemenceau, qui ne sont pas assez purs aux yeux du citoyen Jules Guesde, ancien rédacteur des Droits de l’Homme, du Bien public, et en dernier lieu, de la Révolution française.
C’est dans une conférence, par lui faite à Nîmes, que le citoyen Jules Guesde a lancé l’anathème sur MM. Louis Blanc et Clemenceau. Hâtons-nous de dire que deux députés du département, MM. Bosc et Bousquet ont protesté séance tenante contre les accusations de M. Guesde.
En outre, deux autres protestations ont été faites le lendemain par le Petit Méridional : la première émane du cercle de la Bourse, sous les auspices duquel M. Guesde s’était placé ; la seconde, d’une réunion d’ouvriers. »
L’intransigeance de Guesde détonne dans le paysage politique. Il faut dire qu’il se confronte avec l’État avec virulence : condamné, quelques mois plus tôt, Guesde avait été incarcéré à la prison de Saint-Pélagie où toute une lignée de prestigieux révolutionnaires fut enfermée avant lui. Guesde prend la suite de Blanqui (avec qui il fera quelques meetings en 1880 peu avant sa mort), Raspail, Vallès, et tant d’autres.
Un écrit résume bien ses opinions : Le Collectivisme par la révolution, rédigé au début de l’année 1879, alors qu’il est transféré à l’hôpital Necker pour raisons de santé. Guesde affirme la nécessaire « socialisation des moyens de production » et annonce avec enthousiasme la disparition de « l’oisiveté, mère et fille de l’exploitation de l’homme par l’homme ; et, avec l’oisiveté, […] le spectacle de la richesse en-de-hors du travail, du bien-être, de la consommation sans production équivalente ». Pour lui la Révolution est le moyen de fonder une société harmonieuse pour « fondre toutes les classes dans une seule, celle des travailleurs, au service desquels devra être mis l’ensemble des capitaux de production ». Pour Guesde, le renversement de l’ « État bourgeois » ne fait aucun doute.

Mais revenons au congrès, où les partisans de Guesde – en son absence donc – sont à la manœuvre. Le congrès s’ouvre le 20 octobre 1879 à Marseille et réunit 130 délégués de plus de quarante villes différentes. 2 000 auditeurs vont écouter les débats, pour la plupart des militants. Nul hasard dans le choix de cette ville où les groupes socialistes se sont multipliés depuis quelques années, et où la surveillance et le traumatisme de la répression de la Commune sont moindres que dans la capitale.
La salle du congrès est ornée de devises inscrites sur les murs. On y retrouve la devise républicaine, un peu modifiée : « Liberté, Égalité, Solidarité ». La confiance dans le pouvoir de la science, indissociable de la justice sociale est affirmée : « Science, paix, justice ». Ou encore : « Pas de devoirs sans droits, pas de droits sans devoirs », qui reprend à peu de choses près une des phrases du chant élaboré par le communard Eugène Pottier, L’Internationale.
Le congrès reçoit de multiples salutations de l’étranger, des Communards réfugiés à l’étranger ou encore de socialistes de toute l’Europe ; notamment d’Allemands, qui comptent construire une solidarité par-delà les frontières. La presse socialiste relate avec enthousiasme les applaudissements nourris qui ponctuent le congrès.
L’historien Claude Willard a pu qualifier ce congrès de Marseille comme « une accueillante auberge espagnole ». Il est clair que la diversité est de mise entre les républicains radicaux, des mutuellistes, des anarchistes… ou des « socialistes » de diverses obédiences, dont les contours sont encore bien flous.
À la Une de La Presse du 15 septembre 1879, peu de temps avant l’ouverture du congrès, les questions posées par le congrès ouvrier font réfléchir… mais aussi frémir. La République est consolidée depuis peu avec l’élection de Jules Grévy à la présidence quelques mois plus tôt (Mac-Mahon, le précédent, était ouvertement hostile au régime). La période la plus réactionnaire semble désormais révolue. Aussi une forme de bienveillance est à relever dans La Presse, qui regarde du côté gauche après avoir écarté le péril monarchiste :

« Le 22 septembre prochain doit s’ouvrir à Marseille un troisième congrès ouvrier, et nous pouvons constater avec la plus grande satisfaction que nous sommes bien loin du temps où la perspective d’une pareille réunion effrayait le gouvernement et les citoyens.
Aujourd’hui tout le monde comprend l’importance de ces assemblées où les travailleurs peuvent discuter librement toutes les questions qui les intéressent et étudier les réformes sociales qu’ils ont à réclamer […].
Les travaux du congrès de Marseille seront donc suivis avec la plus grande attention, et nous ne doutons pas que les organisateurs de cette grande réunion ouvrière n’aient à cœur d’éviter tout acte qui pourrait compromettre la cause qu’ils veulent défendre. »
Bref, si les réformes et les compromis sont possibles, aucun problème. La Presse poursuit :
« Si le congrès ouvrier sait se refermer avec sagesse, avec modération dans l’étude des questions sociales, il peut produire les résultats les plus excellents et les plus féconds. »
Mais déjà des inquiétudes se font jour autour de l’intitulé même de « Parti ouvrier » :
« À cet égard nous regrettons vivement le mot de “parti ouvrier” dont on s’est servi à l’occasion de ce congrès. Il indique de la part de ceux qui émettent de pareilles idées l’intention détestable de séparer la cause des ouvriers du reste de la nation […]
Nous espérons que la majorité des membres du congrès fera justice des hérésies que contient le programme rédigé en dehors d’elle et qui n’engage que ses auteurs. »

Vaines espérances : le congrès lui-même est traversé par de multiples sensibilités et tensions mais déjà pointe un certain horizon « collectiviste ».
La presse conservatrice se déchaîne, au grand désespoir des républicains les plus susceptibles d’intégrer les questions sociales ; La Lanterne, journal politique républicain, fait le bilan des résolutions de Marseille. Elle constate tout de même à la fin du mois d’octobre (26 octobre 1879), en plein déroulement du congrès, que les descriptions les plus caricaturales n’ont pas pu emporter l’adhésion au regard des premiers échanges :
« Les journaux réactionnaires, qui comptaient sans doute trouver dans le congrès ouvrier une ample moisson de déclamations sur le péril social, et qui tiennent minutieusement leurs lecteurs au courant de ce qui s’y passe, sont eux-mêmes obligés de s’abstenir de tout commentaire malveillant. »
Les républicains de La Lanterne espèrent que la voie d’une solution à la question sociale se profile. Plein d’enthousiasme, le même article affirme :
« Que d’ici la fin du congrès il se produise quelques exagérations, cela n’est pas impossible ; toutes les institutions humaines ont leurs imperfections, les assemblées ouvrières comme les autres […].
Mais l’esprit pratique de la majorité des membres du congrès de Marseille est évident ; les plus malveillants seront obligés de convenir que ces ouvriers si calomniés, qu’on représente toujours comme n’espérant qu’en la force, qu’en l’insurrection, comprennent maintenant que l’heure des révolutions est passée, et qu’ils n’espèrent la satisfaction de leurs revendications que par des moyens légaux. »
L’avenir ne fait aucun doute :
« Aujourd’hui, l’urne est devenue la barricade du droit ; tous les hommes de bon sens comprennent que le bulletin de vote a remplacé le fusil. Avec la liberté, cette question sociale, qui fait si grand-peur aux hommes du centre gauche, se résoudra légalement. »
L’histoire ne s’est pas passée ainsi. L’affirmation d’un Parti ouvrier comme parti de classe, pensé comme séparé du monde bourgeois et du reste de la République, devait en effet connaître une certaine fortune sous l’influence du marxisme.
Le congrès de Marseille est finalement marqué par une nette tonalité « collectiviste ». La déclaration finale affirme que « l’appropriation collective de tous les instruments de travail et forces de production doit être poursuivie par tous les moyens possibles ». Reste que les effectifs du jeune parti demeurent fort modestes : quelques milliers de membres s’inscrivent une « fédération des travailleurs socialistes de France » découpés en six grandes régions largement autonomes (Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, Lille et Alger, qui est alors considéré comme la France).
Guesde, chargé du programme, se rend à Londres avec quelques autres où il va rencontrer un certain Karl Marx, avec qui il co-rédige les « considérants du parti ouvrier ». Les congrès qui suivent les valident : le premier programme politique marxiste était né.
Bien que le parti demeure fort modeste en termes d’effectifs, cela suffit à affoler la presse conservatrice, qui y voit une insupportable trahison : comment un Français peut-il oser pactiser avec un Allemand, dix ans après la guerre de 1870 et l’annexion de l’Alsace-Lorraine ? Le 29 novembre 1882, Le Figaro, sous la plume de H. de Maureal, s’interroge ainsi avec un long article décrivant l’état des forces socialistes : « L’Internationale existe-t-elle ? ». Il évoque « la dictature de Karl Marx » et appelle à prendre conscience de l’ancrage du phénomène :
« L’Internationale n’existe plus en tant qu’internationale ; parce qu’elle a été remplacée par autre chose, par plusieurs partis révolutionnaires nationaux […].
Si la société court un péril prochain ou éloigné de révolution, c’est par le fait des cinq cents Chambres syndicales ou groupes français, recevant une direction française, qui existe sur le territoire national. »
On relève l’importance des partisans de Guesde, les « guesdistes » :
« Dans le jargon politique, les sectateurs de Karl Marx et de M. Guesde s’appellent autoritaires Marxistes ou Guesdistes. L’École rivale s’intitule libertaire. »
La conclusion est sans détour : il ne faut plus lutter contre « l’Internationale » mais bien contre ceux qui agissent en France :
« C’est là qu’est le péril social. À notre avis, il est plus urgent de prendre contre ces 460 sociétés non autorisées des mesures préventives que de dépenser ses forces à défendre une loi sans portée, puisque ceux qu’elle vise n’existent plus.
Qu’on abroge donc, si l’on veut, la loi contre l’Internationale, mais qu’on édicte une bonne loi contre le parti révolutionnaire anti-national et anti-français dont nous venons de montrer la force. »
C’est le début de longues batailles. Lorsque Guesde se présente aux élections législatives, il est toujours stigmatisé comme « anti-Français » parce qu’il est lié à des marxistes allemands.
Même devenu député en 1893, il restera jusqu’en 1914 une des cibles favorites de la presse conservatrice.
–
Jean-Numa Ducange est historien, maître de conférences en histoire contemporaine à l’université de Rouen. Il vient de publier, en compagnie de Antony Burlaud, Marx, une passion française aux éditions La Découverte.