NOUVEAU
RetroNews | la Revue n°4
Quatre regards pour une histoire environnementale, un dossier femmes de presse, un chapitre dans la guerre, et toujours plus d'archives emblématiques.
Pour accéder à l’ensemble des fonctionnalités de recherche et à tous les contenus éditoriaux, abonnez-vous dès aujourd’hui !
Pour accéder à l’ensemble des fonctionnalités de recherche et à tous les contenus éditoriaux, abonnez-vous dès aujourd’hui !
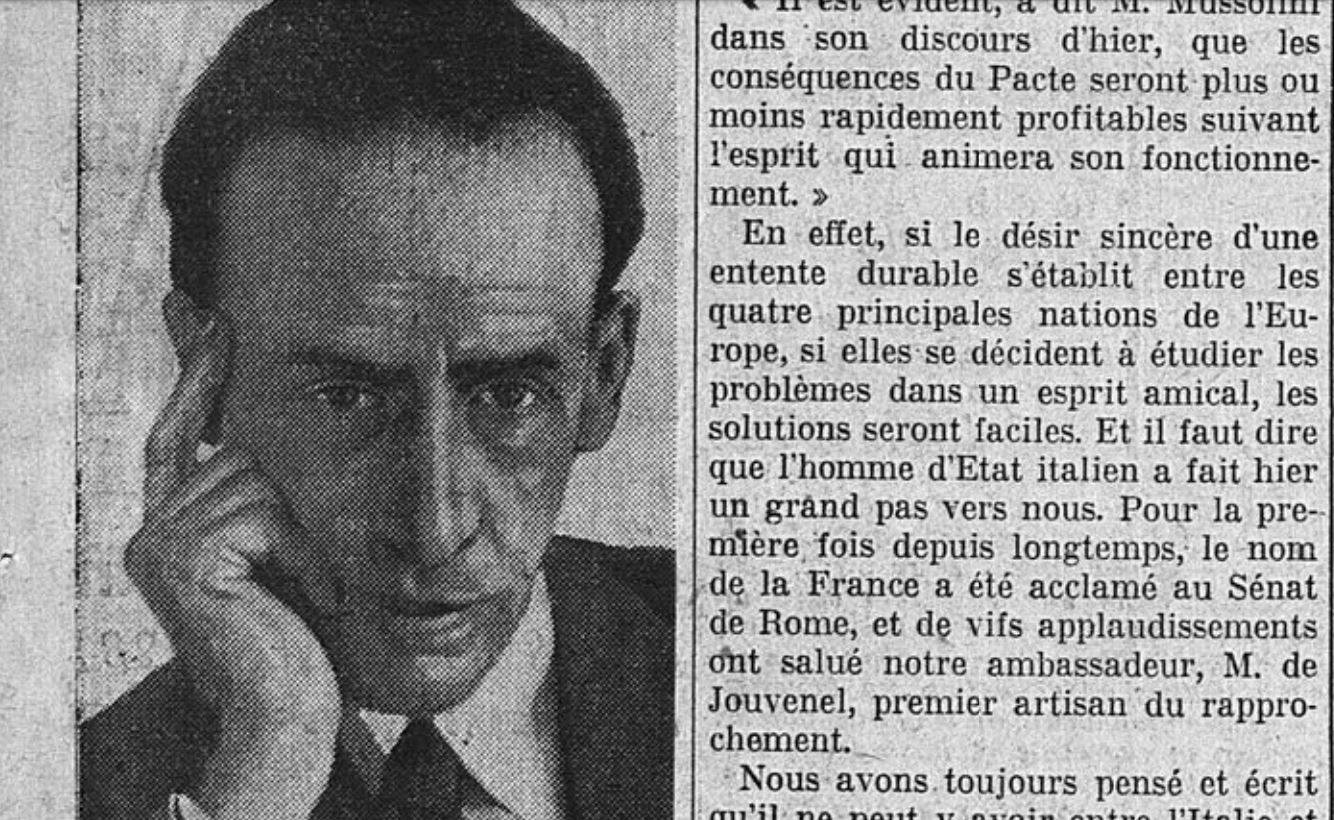
Correspondant pour le Chicago Tribune en Allemagne, le journaliste Geoffrey Fraser est arrêté par le gouvernement nazi sur le seuil de sa porte au mois d’avril 1933. Lorsqu’il sort après presque 40 jours de calvaire, L’Intransigeant publie son témoignage des prisons d’outre-Rhin.
Dans la nuit du 4 au 5 avril 1933, le journaliste britannique Geoffrey Fraser est arrêté à Berlin par « un groupe de nazis armés ». Ancien correspondant en Allemagne (1928-1929) de l’édition européenne du Chicago Tribune and the Daily News, Fraser avait été aussi rédacteur de l’Agence allemande Transocéan (1929-1933), contrat auquel il avait mis fin suite à l’arrivée d’Hitler au pouvoir.
En novembre 1933, Le Petit Parisien aura maille à partir avec le IIIe Reich et son ministre de la Propagande Goebbels. En soutien à son confrère, Geoffrey Fraser lui enverra une lettre-ouverte publiée dans l’édition du 19 novembre, dans laquelle il reviendra sur son départ de l’agence :
« Avant le régime hitlérien, Transocéan, tout en exprimant le point de vue allemand, s'efforçait honnêtement de ne pas devenir une agence de propagande, mais d'émettre des informations sérieuses. L'arrivée d'Hitler au pouvoir a changé tout cela […].
Je n'avais aucune envie de devenir un agent de propagande hitlérien et le gouvernement naziste n'avait aucune envie de garder à son service un journaliste anglais qui n'avait jamais caché l'horreur que lui inspiraient les méthodes hitlériennes. »

NOUVEAU
RetroNews | la Revue n°4
Quatre regards pour une histoire environnementale, un dossier femmes de presse, un chapitre dans la guerre, et toujours plus d'archives emblématiques.
Ce sentiment d’« horreur », Geoffrey Fraser a eu l’occasion quelques mois auparavant d’en entretenir avec précision le lecteur français. Grâce aux démarches du gouvernement britannique, il est enfin libéré trente-neuf jours après son arrestation, et s’installe en France. Un titre de la presse française, L’Intransigeant, va s’emparer de son histoire, en lui offrant de la raconter dans ses colonnes. Ce journal est ainsi fier d’annoncer, en première page de son édition du 8 juin, qu’il « s’est assuré l’exclusivité du récit de Geoffrey Fraser ».
La série s’intitule « Ce que j’ai vu dans les prisons allemandes » : elle débute le lendemain, précédée d’un surtitre, « Prisonnier politique », et est accompagnée d’un portrait du journaliste anglais. Elle comportera cinq articles et se terminera le 14 juin. C’est à travers elle que nous allons suivre le déroulement de l’arrestation du journaliste et avoir connaissance des conditions de sa détention.
Cette fameuse nuit, Geoffrey Fraser a la surprise de découvrir des « policiers en uniforme devant [son] palier, qui avaient été chercher la concierge pour essayer d’ouvrir [sa] porte ». Il précise :
« On était venu en force : je trouvai devant ma porte un commissaire en civil de la police politique, un commissaire nazi, quatre agents de police et quatre hommes des troupes d’assaut. »
La perquisition dure deux heures, et, à son issue, stupéfaction, on l’arrête. Il insiste alors sur son « droit » d’obtenir « un inventaire des papiers saisis chez [lui] », inventaire auquel il doit procéder lui-même.
Le journaliste anglais est d’abord emmené au poste de police de la Joachimstaler Strasse, où il subit des insultes de la part de deux agents :
« Salaud d’Anglais... on va vous balancer tous, vous autres espions de la presse étrangère... pour bien faire on devrait vous pendre tous... »
Il se retrouve ensuite à Alexander Platz dans les locaux de la préfecture de police :
« Pendant les cinq heures qui s’ensuivirent on me traîna de chambre en chambre, de bureau en bureau. Chaque fois je devais attendre, puis faire les mêmes réponses dix fois de suite à des tas de questions stupides posées par dix commissaires vraiment peu intelligents. »
Puis, emmené au « Horst Wessel Haus », lieu de la police politique hitlérienne, il endure « environ quatre heures un interrogatoire serré par un commissaire nazi […] ». Aucun répit n’est donc laissé au journaliste.
Dès le 5 avril, au matin de son arrestation, de nombreux communiqués dans la presse française, nationale comme régionale, publient la dépêche informant de celle-ci. Elle est parfois complétée par ces mots, comme dans L’Ouest-éclair de Rennes :
« Les amis de M. Fraser ont immédiatement communiqué avec les autorités consulaires britanniques, qui ont avisé le gouvernement allemand et lui ont demandé des explications. »
Des interpellations en sont dès lors l’objet à la Chambre des Communes. L’arrestation d’un journaliste suscite toujours des remous, et du gouvernement britannique à la presse internationale, on suit cette affaire avec attention.
Après le « Horst Wessel Haus », Fraser est incarcéré à la prison de la préfecture de police, dans une cave où croupissent quarante-sept « prévenus politiques ». Ici, ainsi que nous le verrons, il va se confronter au pire de ce que l’humain peut engendrer, et trouver le meilleur de ce qu’il est en capacité de donner. Puis il est transféré de la cave au premier étage, dans une « salle bien claire, propre, aérée, munie de matelas et de couvertures ». Il ajoute :
« Il y avait là de trente à quarante prisonniers politiques, dont la plupart attendaient d’être transférés dans des camps de concentration. »
Le 13 avril, le correspondant du quotidien socialiste Le Populaire à Londres détaille, grâce au rapport de l’ambassadeur de Grande-Bretagne, les motifs de son arrestation :
« […] C'est pour avoir été en possession de documents relatant de façon inexacte les récents événements survenus en Allemagne, que M. Fraser a été arrêté. Il est également soupçonné d'avoir eu l'intention de répandre ces fausses informations parmi l'armée et la police. »
Dans son récit publié dans L’Intransigeant, Fraser précise qu’il devait alors être « jugé à la Cour Suprême du Reich, à Leipzig et [qu’il] écoperait probablement de cinq à dix ans de travaux forcés ».
Le Populaire annonce également dans son article que le consul britannique à Berlin a enfin été autorisé à « s’entretenir avec l'inculpé ».
Fraser raconte cette visite dans son article du 13 juin de L’Intransigeant : elle se déroule en fait avec le consul et un vice-consul, sous haute surveillance du juge d’instruction. Sont-ce les conséquences de cette visite officielle ? Ses conditions de détention changent, et il peut prendre un avocat. Mais la démarche n’est pas si aisée, ainsi que le stipule Fraser :
« Aucun avocat n’a, sous ce singulier régime qui se dit civilisé, le droit de défendre un prévenu politique sans la permission expresse du procureur du Reich à Leipzig.
Cette permission n’est accordée qu'à un nombre fort restreint d'avocats, ce qui fait que ceux qui sont ainsi privilégiés ont une espèce de monopole qui leur permet de demander à leurs clients des honoraires tout à fait exagérés. »
« […] Ce singulier régime qui se dit civilisé […] » : ces mots sont importants, car ils conditionnent la grande part de l’argumentation développée par Fraser dans sa série, et l’une de ses optiques principales. Montrer que l’Allemagne est aux mains d’un régime autoritaire, fasciste ; dénoncer la répression y sévissant et les pratiques y ayant cours, qui ressortent de la barbarie.
Ainsi le journaliste britannique décrit-il à plusieurs reprises les « choses horribles » subies par ces « victimes des bandits hitlériens », les sévices dont il constate avec effroi les stigmates sur les corps de ses codétenus, les tortures qu’on lui relate. Il faut absolument, en dehors de cette cave, en dehors de cette pièce, en dehors de ces geôles où transpirent la détresse et la souffrance, il faut absolument que le monde sache ce qui se passe en Allemagne nazie. L’Intransigeant lui permet de délivrer cette information :
« Dans certains des établissements nazis où l’on avait ‘cuisiné’ les prisonniers, les chefs avaient pris la précaution de n’infliger à leurs victimes que des blessures qui ne paraîtraient pas quand on les transporterait dans la rue pour les jeter en prison.
Avant de les torturer, on les avait déshabillés. Plusieurs de ces malheureux se déshabillèrent pour me montrer l’état de leurs corps. Dans deux cas, on avait infligé un traitement d’un sadisme tellement inouï qu’on ne peut en donner même une indication dans la presse. »
Mais cette simple mention édulcorée fournit au lecteur le moyen de saisir ce qu’endurent ces prisonniers, de comprendre que le verbe est incapable de dire l’inimaginable, « l’horreur » à l’état brut. La série de Fraser insiste sur les tortures, sur « tous les raffinements de cruauté dont ces bourreaux ont tous les secrets ». En avril 1933, celle-ci s’impose dès lors comme marque du régime nazi, comme son mode d’être.
Face à cette barbarie, des hommes se dressent. Ce sont eux que le journaliste britannique côtoie en détention, eux seuls qui maintiennent vivante la civilisation allemande, sa culture, détruites toutes deux par leurs bourreaux :
« Et ces visions épouvantables m’aidèrent à supporter mon propre sort, car elles me rappelaient combien petites et mesquines étaient, après tout, mes souffrances à côté de celles de ces centaines, de ces milliers de victimes du ‘Führer’, dont les discours éloquents et hypocrites proclament les hautes qualités morales de la ‘Kultur’ allemande. »
Geoffrey Fraser est ébranlé par les corps meurtris de ces opposants. Il est aussi abasourdi par leur courage, ainsi qu’il le souligne dans son article du 10 juin :
« Je voudrais ici exprimer tous mes remerciements à ces compagnons de deux jours, pour la sympathie dont ils m’ont entouré, et toute mon admiration pour leur courage et leur constance dans l'adversité.
Après les choses tragiques et douloureuses dont j’avais été témoin, je sentis renaître en moi un peu d’espérance. »
Ces lignes laissent en outre transparaître le sentiment noble que Fraser va découvrir dans ces prisons : la fraternité. Une fraternité profondément humaine, mais également militante, qu’il va ressentir de façon la plus tangible possible, tel à ce moment précédant son transfert à la prison de Moabit :
« Mes camarades de chambrée me firent des adieux touchants. Comme les nazis m’avaient volé mon argent, je n’avais qu’un mark en poche et mes compagnons savaient que j’étais pour le moment, jusqu’à ce que je réussisse à établir les communications avec le monde extérieur, absolument sans ressources.
En un clin d’œil, mes poches furent remplies de cigarettes, chocolat, biscuits, oranges et que sais-je encore. Comme le garde venait me chercher, ils me serrèrent tous la main et me saluèrent d’un vibrant ‘Rot Front !’ qui est à la fois le salut et le cri de bataille des communistes allemands. »
Cette fraternité des militants, que l’on fait partager de plus à quelqu’un qui n’en est pas un, marquera durablement le journaliste, ainsi que nous enjoint à le penser sa série. Mais il emporte aussi avec lui le souvenir des sévices subis par ces hommes courageux, comme il le mentionne dans son article du 10 juin :
« Les choses terribles que j’ai vues dans cette cave et dans une autre non moins sinistre, dans laquelle nous dûmes déménager au beau milieu de la nuit suivante pour laisser place à une nouvelle fournée de malheureux, ne s’effaceront jamais de ma mémoire. »
La suite de l’itinéraire du journaliste en atteste, et, concernant le régime nazi, sa bataille contre celui-ci ne s’arrêtera pas là. De sa lettre-ouverte publiée dans Le Petit Parisien en novembre 1933 à ses articles de commentaire, chroniques ou reportages publiés postérieurement, il ne cessera de le dénoncer, ainsi que les autres fascismes.
Une fois sa liberté retrouvée, on l’a compris, Geoffrey Fraser a continué d’exercer son métier de journaliste. Il collabore à plusieurs journaux français, dont l’organe de la Ligue Contre l’Antisémitisme (LICA), Le Droit de vivre, où il est rédacteur. En octobre 1936, effectuant un reportage en Autriche, il est arrêté, accusé d’activité communiste. Condamné à six semaines d’arrêt, il est finalement expulsé. Contant son aventure dans Le Droit de vivre du 17 octobre 1936, il débute ainsi son article :
« En 1933, Hitler me faisait arrêter pour avoir, soi-disant, envoyé des fausses nouvelles au sujet des atrocités commises par ses bandes ivres de sang et de fièvre raciste. Pour m’aliéner la sympathie du public bourgeois, il m’accusa "d’activité communiste". Sommé par le gouvernement britannique de fournir les preuves de ces allégations, il ne put le faire.
Je fus relâché, et expulsé.
En 1936, Schuschnigg me fait arrêter pour avoir en ma possession des "informations subversives" et des "brochures communistes", et pour être en relations suivies avec "un bureau central communiste à Paris". Étant dans l’impossibilité de prouver ces allégations,
Schuschnigg, à son tour, a dû me relâcher >et a cru nécessaire de m’interdire le séjour en Autriche.
On le voit : les fascismes se ressemblent. Mêmes buts, mêmes méthodes, mêmes mensonges, mêmes résultats. »
Face à eux, il y eut aussi des journalistes comme Geoffrey Fraser, qui n’abdiquèrent pas devant l’intimidation et la répression.
–
Anne Mathieu est historienne, maîtresse de conférences habilitée à diriger des recherches à l’Université de Lorraine et membre de l'Unité Plurielles de l'Université Bordeaux Montaigne.