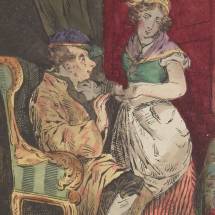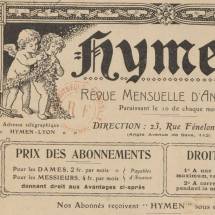L'histoire méconnue de la noblesse célibataire du XVIIe siècle
Les nobles du XVIIe siècle ont destiné la moitié de leurs enfants au célibat. Comment expliquer ce phénomène – qui ne porte alors pas encore le nom qu'on lui connaît aujourd'hui ? Que vivaient celles et ceux qui ne se mariaient pas ? L'historienne Juliette Eyméoud donne corps à cette histoire méconnue dans son ouvrage Le Siècle du célibat.
RetroNews : Comment le célibat est-il défini et perçu au XVIIe siècle ?
Juliette Eyméoud : Au XVIIe, le mot célibat s’emploie principalement pour parler du célibat des prêtres, c'est-à-dire du célibat consacré. Jusqu’au XVIIIe siècle, il n’y a pas vraiment de terme pour désigner les individus non-mariés ; le mot apparaît dans les dictionnaires français dans les années 1760.
En revanche, une expression se forge au XVIIe siècle, celle de « fille majeure » parfois complétée par « usante et jouissante de ses biens et droits ». Mais il s’agit là d’exprimer un statut légal : les femmes non-mariées de plus de 25 ans se trouvent effectivement libres de toute tutelle, elles peuvent gérer leurs biens sans contrainte. Il n’y a pas d’équivalent chez les hommes, ou du moins l’expression « garçon majeur », que l’on rencontrait parfois au XVIe siècle, n’est pas usitée.
Pour ce qui est de la perception du célibat, peu de sources nous en informent. À nouveau, il faut regarder du côté du XVIIIe siècle pour voir apparaître des pièces de théâtre ou des représentations iconographiques de vieux garçons, de vieilles filles, de célibataires débauchés (toujours des hommes, dans ce cas).
En quoi la noblesse est-elle un bon observatoire de ce phénomène ?
Ce que j’ai pu observer, dans l’échantillon de familles que j’ai étudiées, c’est qu’on assiste à une recrudescence du célibat au XVIIe siècle. Dans ces lignages nobles, près de la moitié des hommes et femmes, nés entre 1600 et 1699, ne se marient pas. Il faut préciser que je compte les religieux et religieuses au nombre des individus non-mariés, mais le célibat laïc n’est pas en reste. L’apparition des « filles majeures », mentionnées précédemment, en est l’expression chez les femmes. Grosso modo, au cours du siècle, ½ des hommes se marient, ¼ entre dans les ordres, ¼ demeure célibataire dans le siècle ; près de la moitié des femmes prennent le voile, ¼ se marient et ¼ deviennent filles majeures.
La noblesse est un bon observatoire du phénomène parce qu’elle a laissé des archives. Le patrimoine qu’elle possède doit être géré, ce qui crée des traces. C’est principalement à partir de ces traces, soit les archives notariales, que j’ai travaillé. Elles m’ont permis de reconstituer des fratries, de voir apparaître des individus non-mariés qui y sont donateurs ou testateurs, donataires ou légataires.
Que sait-on des motivations qui conduisent alors les nobles à choisir le célibat ?
Il est presque impossible de les connaître. La notion de choix, très contemporaine, s’applique mal aux logiques d’Ancien Régime.
En tout cas, c’est un débat : les individus ont-ils le choix, au sein d’une société où le lignage, la famille, le nom doivent primer ? De plus, nous manquons de sources pour interroger des choix éventuels. Je n’ai pas eu la chance de découvrir des écrits intimes, de type journal ou correspondances.
En revanche, vue la masse des célibataires au sein de familles de différentes noblesses (épée, robe, parisienne, provinciale) on peut parler d’une politique du célibat noble au XVIIe siècle. Il apparaît qu’un choix conscient a été fait, par les familles, sur plusieurs générations, de ne marier qu’un fils et une fille par fratrie, et cela pour favoriser la protection du patrimoine et la concentration des biens sur une lignée (celle de l’aîné mâle en grande majorité).
À côté du célibat religieux, quelles formes le célibat laïc prend-il ?
Pour les hommes, on pense bien sûr à des carrières militaires, mais ce n’est pas le seul chemin possible. Pour les femmes, la diversité est encore plus grande : certaines passent leur vie auprès d’un ou plusieurs membres de leur famille (frère aîné pour s’occuper des neveux et nièces, mère devenue veuve, sœur elle aussi célibataire, etc.), d’autres mènent grand train dans un hôtel particulier qu’elles occupent seules, d’autres encore vivent dans une hôtellerie de couvent sans prendre le voile pour autant.
En bref, le célibat laïc prend des formes variées, et la 3e partie du livre s’applique à rendre compte de cette diversité de trajectoires.
Le fait de ne pas être marié ne semble pas être considéré comme une tare sociale. Ce qui est très intéressant à observer c’est qu’ils et elles sont parfois à la tête de véritables fortunes, mais que cette fortune retourne presque immanquablement à leur famille par le biais de donations ou de legs à des frères aînés, des neveux, des nièces. Les célibataires devaient donc être considérés comme des individus importants du lignage, des protecteurs du patrimoine.
Que sait-on du célibat au sein des autres classes sociales ?
Très peu de travaux s’y sont intéressés pour l’instant, du moins pour ce qui est de la discipline historique. On peut citer la thèse en cours de Celia Enriquez Rubal, qui travaille sur les célibataires dans l’Espagne des XVIIIe et XIXe siècles. Ou encore le travail de Ryan Hilliard (université de Los Angeles) sur les femmes célibataires à Paris au XVIIIe siècle – mais qui n’a pas fait l’objet de publication pour le moment.
Quelles sources avez-vous mobilisées ?
J’ai d’abord consulté les généalogies imprimées, réalisées aux XVIIe et XVIIIe siècles, consacrées aux quatre familles de mon corpus. Cela m’a permis d’identifier les célibataires de chaque génération (mentionnés comme « sans alliance », « garçon », « fille », « sans postérité »).
Mais mes sources principales sont des archives de notaire : testaments, donations, inventaires après décès, règlement de succession, etc. Ces archives du quasi-quotidien, de la vie pratique, ont dévoilé d’autres célibataires qui avaient disparu des mémoires et n’avaient pas été nommés dans les généalogies ci-dessus.
De manière plus sporadique, j’ai également travaillé à partir de sources littéraires (mémoires, correspondances imprimées comme celle de Bussy-Rabutin ou de Mme de Sévigné, pièces de théâtre...) ou iconographiques.
Comment expliquer le relatif vide historiographique qui prévalait jusqu’ici ?
Il n’est pas toujours facile de retrouver les célibataires. Les généalogies imprimées n’en font pas forcément mention car leur objectif est, le plus souvent, de tenir la liste des futurs héritiers d’un lignage. De fait, une personne célibataire n’ayant pas de descendance légitime, elle n’intéresse pas les généalogistes.
Par ailleurs, il n’y a pas vraiment de mots pour désigner le célibat laïc, comme je le disais précédemment donc il n’est pas toujours aisé de savoir si une personne mentionnée dans une source est ou non célibataire.
En somme, il fallait s’intéresser au phénomène du célibat pour avoir une chance de débusquer des célibataires dans les archives. Or, l’historiographie s’est davantage penchée sur le mariage, sur le couple, sur la famille « traditionnelle » telle qu’on se la représente avec nos mentalités contemporaines.
-
Juliette Eyméoud est historienne, docteure en histoire moderne et conservatrice des bibliothèques. Sa thèse, réalisée à l’EHESS, portait sur le célibat dans la noblesse française d’Ancien Régime. Son ouvrage Le siècle du célibat est paru en janvier 2025 aux Presses universitaires de Rennes.