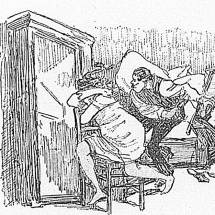Les Français de la Belle Époque : trajectoires croisées en République
Dans son ouvrage Les Français de la Belle Époque, l'historien Antoine Prost dresse un tableau vivant des contemporains du début du XXe siècle, avec l'ambition d’embrasser le destin d'une société toute entière.
Spécialiste de la société française du XXe siècle, l'historien Antoine Prost a consacré un ouvrage aux Français de la Belle Époque, véritable tableau vivant des contemporains de cette période riche en progrès et en changements, mais également en divisions et en conflits. Comment les Français vivaient-ils alors ? Comment se voyaient-ils eux-mêmes ? Avaient-ils seulement conscience de vivre une « belle époque » ?
Propos recueillis par Marina Bellot
–
RetroNews : De quand date l'expression « Belle Époque » ? Reflète-t-elle ce que les Français ont le sentiment de vivre alors ?
Antoine Prost : L’expression de Belle Époque date du début des années 1940, ce qui est beaucoup plus tardif que je ne le pensais, et apparaît en partie à cause du retour de la guerre. On ne mesure pas aujourd’hui à quel point les Français de l’entre-deux-guerres ont vécu dans une anxiété latente.
Les gens de la Belle Époque n'avaient, eux, pas le sentiment de vivre une belle époque. Néanmoins, ils avaient conscience de vivre une période de progrès. La République avait gagné son pari : elle s'était implantée, avait gagné une bonne partie des campagnes. La France était gouvernée par un gouvernement a minima. L’objectif des républicains était que le Parlement fasse les lois, et que le gouvernement n’ait plus qu’à les appliquer. Les gens étaient très fiers de ce mode de gouvernance, sans égal en Europe.
La France était par ailleurs sortie de la crise des années 1890 : elle avait reconquis une puissance internationale, ce qui était également source de fierté. L’économie progressait. En somme, la France se portait bien, mais elle était traversée par des conflits marqués.
Précisément, votre ambition est de raconter la Belle Époque à travers la voix de ceux qui l'ont vécue ; or faire revivre les Français de cette période, c'est montrer leurs divisions. Quels sont les principaux clivages à l'œuvre dans la société française ?
L’opposition majeure est celle qui existe entre le peuple et les élites. Ferdinand Buisson le définit parfaitement : il y a d’un côté ceux qui possèdent sans travailler, et de l’autre ceux qui travaillent sans posséder. Ça, c’est vraiment la France de la Belle Époque.
On compte alors en France 560 000 rentiers, dont une bonne moitié ont moins de 60 ans et vivent simplement des coupons de leurs obligations de chemin de fer ou des loyers que leur versent leurs fermiers ou leurs locataires. Il faut ajouter à cela tous les avocats qui ne plaident pas, les médecins qui ne soignent pas, les magistrats qui vivent en grande partie de leur rente car l’État ne les paie pas grassement. L’État juge alors bon que les juges et les militaires soient du côté des possédants et donc, de l’ordre. Au total, on arrive à environ un million de rentiers sur 40 millions de Français.
Il y a donc, à côté de ces rentiers, un immense peuple de gagne-petits, de paysans, de journaliers qui se louent à la journée… Et à l’intérieur du peuple, vous avez des conflits secondaires. La question sociale devient très prégnante car un syndicalisme prend forme à partir de la création de la CGT en 1895 et essaie de défendre une autonomie ouvrière. C’est une époque où, dans de nombreuses usines, on ne pointe pas : quand on a fini son travail on peut s’en aller. La mise en place de la discipline d’usine passe mal. C’est très net à Limoges, où le règlement édicté par les porcelainiers et les fabricants de chaussures en 1906 va créer une grève de grande ampleur.
En quoi consiste le paternalisme social qui naît à cette époque ?
Il s’agit d’une transposition à l’industrie d’une relation à l’origine rurale entre le propriétaire des terres et l'exploitant. Le propriétaire noble de l’Ouest est en même temps patron, maire, conseiller général, parfois député. On parle de lui en disant « not’ maître » et les fermiers lui sont attachés. Pourquoi ? Parce qu’il remplit son rôle de patron. Il ne se défile pas pour ses fonctions de maire, il organise les comices agricoles, etc. Il fait le job, pourrait-on dire.
Je cite souvent dans mon livre un ouvrier rural qui travaille dans deux usines : l’une où le patron paternaliste fait ce qu’il faut, trouve du travail à ses ouvriers quand le four est à l’arrêt, etc., et une autre où le patron ne s'en occupe absolument pas. Dans le premier cas, le paternalisme est accepté par les ouvriers parce qu’il impose au patron des devoirs. Ce qui ne va pas, c’est lorsque le patron ne respecte pas ses devoirs ou, pire, quand il manie la répression. C’est le cas au Creusot en 1899 : cela se termine par le départ de 2 000 ouvriers qui quittent l’usine et vont chercher du travail ailleurs.
Mais un autre grand clivage traverse la France de ce temps : c’est la division idéologique entre républicains et catholiques.
Selon vous, l'inégalité entre hommes et femmes à cette époque concerne seulement la bourgeoisie et non pas le peuple. Sur quels critères vous fondez-vous ?
Je serais moins catégorique. Je note que nombre des interdictions qui frappent la bourgeoisie ne frappent pas l’ouvrière ni, d’ailleurs, la paysanne. La femme mariée dans la bourgeoisie est en charge de la reproduction et de l’héritage, et ne gère pas sa fortune personnelle. Elle est totalement soumise à son mari – elle ne peut pas ouvrir de compte en banque par exemple. La femme du peuple, elle, peut parfaitement ouvrir un livret de caisse d’épargne et a toute liberté de le gérer. La bourgeoise demande à son mari l’argent du ménage ; l’ouvrier rapporte sa paye à son épouse.
Il y a toute une série de conditions, soit de droit soit de fait, qui font qu’en réalité la véritable oppression de la femme mariée (et de la concubine) dans les milieux populaires, c’est la violence du mari – ce qui est épouvantable et d’autant plus monstrueux que cette violence est largement tolérée par le voisinage et plus largement, par la société. Ce qui est intéressant aussi, c’est que les femmes des milieux populaires, qui travaillent par nécessité, envient les bourgeoises qui ne sont pas obligées de travailler. D'où le conseil « faites donc la cheminote ! » donné à une sage-femme qui se marie, beaucoup de cheminotes ne travaillant pas à l'époque.
Alimentation, façon de se vêtir, de se divertir... Qu'est-ce qui distingue la France rurale de la France citadine à cette époque ? Dans quels domaines la société commence-t-elle à être unifiée ?
On assiste à une diffusion progressive des usages citadins dans la campagne. L'une des premières évolutions concerne le vêtement : jusque-là dans les villages, le vêtement était fait sur place. Or la couturière commence à être concurrencée. Les robes de mariées s’achètent désormais sur catalogue dans les grands magasins, on ne les fait plus fabriquer par la couturière locale.
L'alimentation paysanne, traditionnellement à base de soupe, évolue vers l’usage de la ville où l’on mange maintenant de la viande à tous les déjeuners. Le service militaire a contribué à développer ces usages alimentaires. De même, on petit-déjeune à la ville avec du café – on dirait de la chicorée aujourd'hui. Eh bien, on commence à voir arriver le café dans les campagnes. Dans mon livre, je parle d'une maison de campagne d’un certain standing où le ménage s'inspire du ménage citadin bourgeois, et où les gens se cachent pour boire du café...
L’influence citadine apparaît aussi à travers l’école bien sûr. Une unification du territoire est en train de se faire : tout le monde ne parle pas français mais tout le monde le comprend, et les jeunes entre eux parlent désormais le français. Des statistiques montrent que l’entre-deux-guerres entérine la francisation totale des parlers locaux. La guerre de 1914 a mis ensemble des Provençaux et des Bretons dans un régiment de Bourguignons… et la seule façon de se comprendre, c’était de parler français.
La France est unifiée aussi par les réseaux routier et ferroviaire, par la Poste, par les impôts, par les poids et mesures... Tout le monde sait ce que sont un kilo et un litre, et ça c’est une unification fondamentale.
Enfin comme je l’évoquais tout à l’heure, les Français de cette époque étaient fiers de vivre en République. Je raconte dans mon livre cette histoire qui figure dans les carnets du sergent Maginot. Maginot, qui est à l’époque député de la Meuse, est mobilisé en 1914. Il prend le train et à Toul, l'un de ses électeurs lui demande ce qu’il fait là. Il lui répond qu’il est mobilisé comme deuxième classe. Le paysan n’en revient pas et s’exclame : « La République, c’est tout de même quelque chose ! ». Ca, c'est fondamental pour l’unité nationale. On n’est pas dans un pays ou les galonnés font la loi. Et cela va rejaillir sur le comportement des soldats pendant la guerre. J'aime beaucoup cette anecdote d’un poilu qui voit arriver dans sa section un lieutenant qui sort de Saint-Cyr et leur fait tout un topo patriotique. Le poilu qui est là depuis le début lui dit alors : « Ferme ta gueule bleusaille et commande ! »
Quels progrès technologiques majeurs marquent cette période ?
C’est la seconde révolution industrielle : c’est l’aluminium, l'électricité, les aciers spéciaux à coupe rapide, les moteurs à explosion, et bien sûr la voiture. La France est en 1910 le premier producteur d'automobiles au monde. Et rendez-vous compte que le premier avion s'est élevé au-dessus du sol en 1906 et qu’à la fin de la guerre de 14, la France avait construit 35 000 avions ! C’est gigantesque. L'explosion de l’automobile et de l’avion constitue une vraie révolution.
L'électricité est aussi une révolution qui va complètement modifier les usines. En 1908, De Dion Bouton, un constructeur de voitures de standing, refait totalement l’une de ses usines et remplace les machines à vapeur par l’électricité. C’en est fini des lignes de production avec les poulies et les courroies de transmission qui relient le plafond à la machine. Avec le moteur électrique, les câbles sont sous le plancher. Et là, le taylorisme apparaît.
–
Antoine Prost est historien, spécialiste de la société du XXe siècle, professeur émérite à l'université Paris-1 Panthéon-Sorbonne et président du conseil scientifique de la Mission du Centenaire 14-18. Son ouvrage Les Français de la Belle Époque est paru aux éditions Gallimard en octobre 2019.